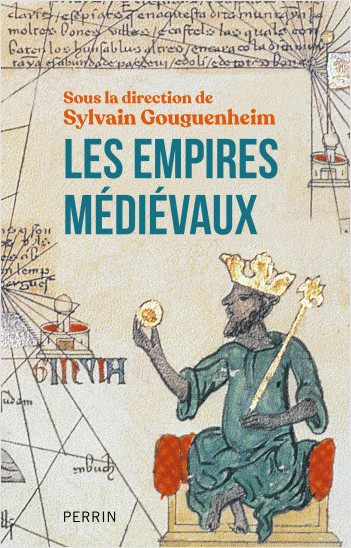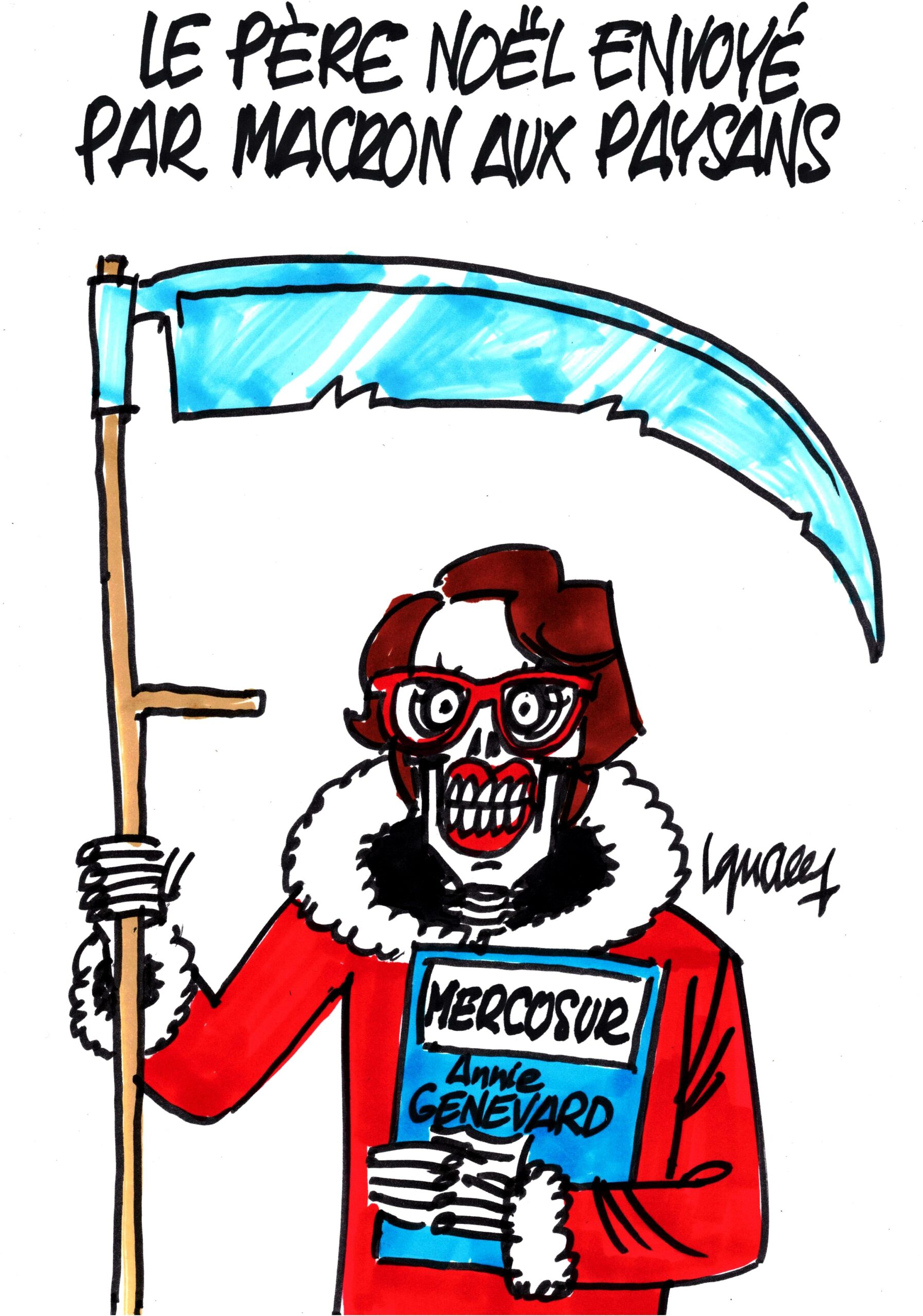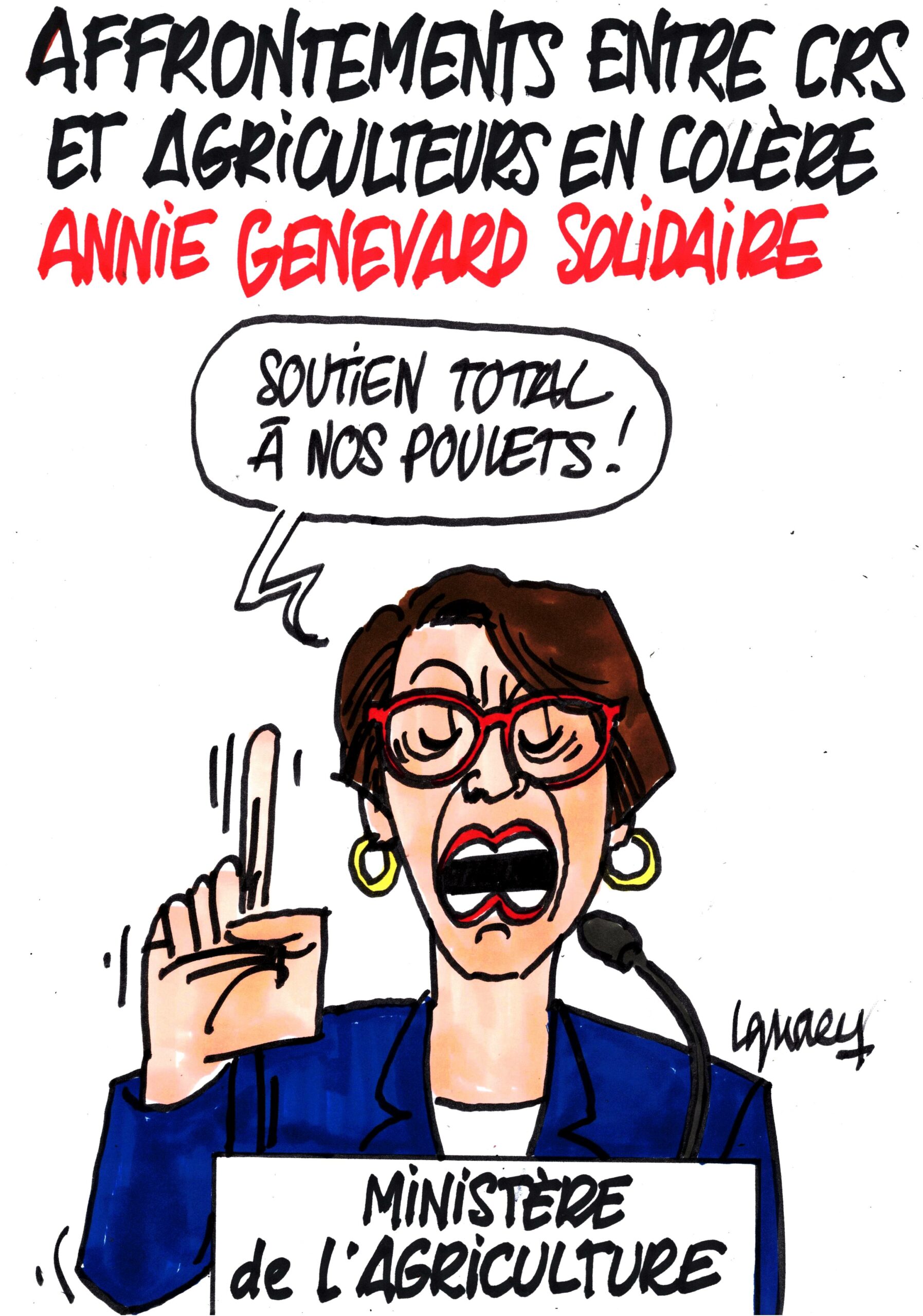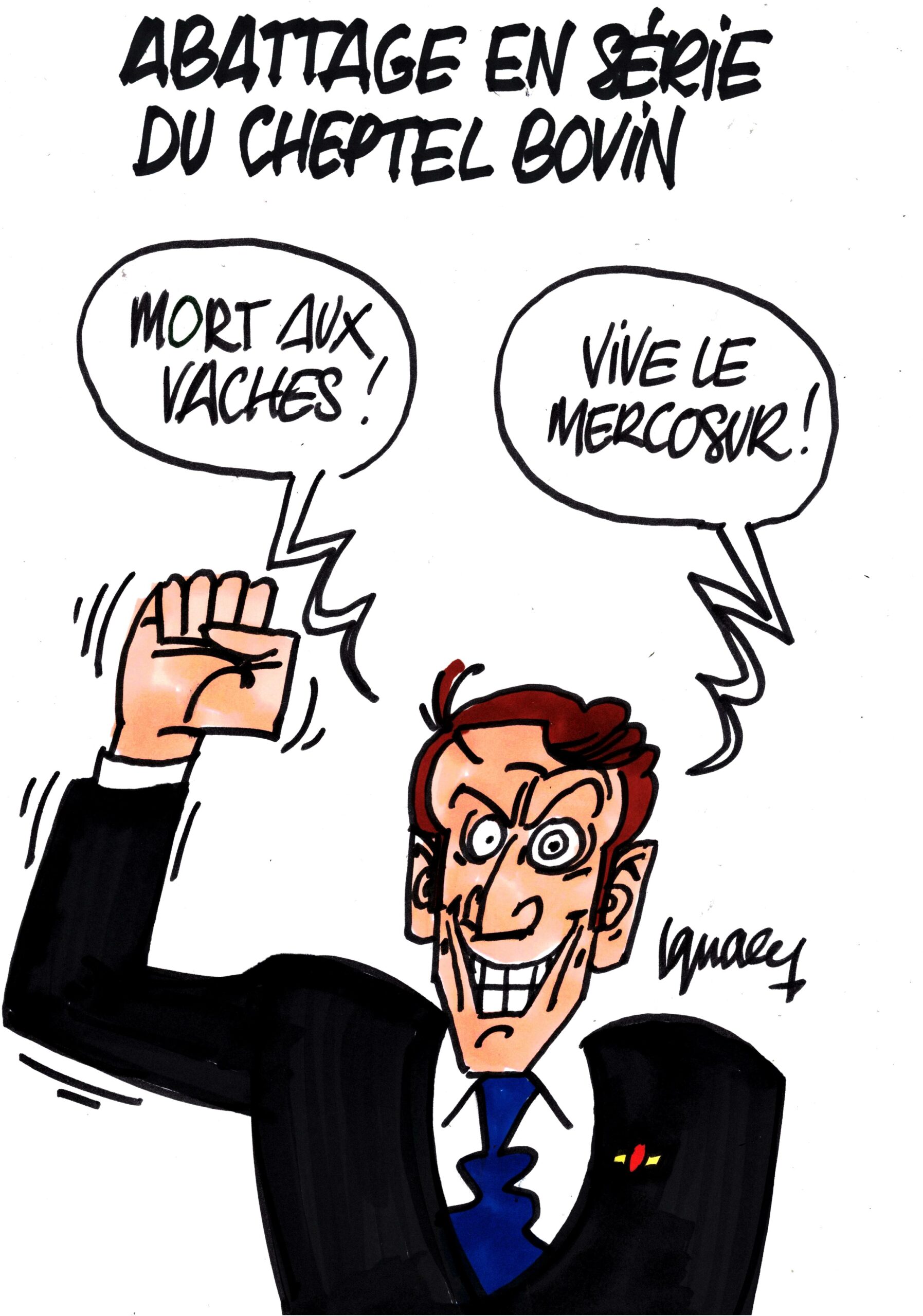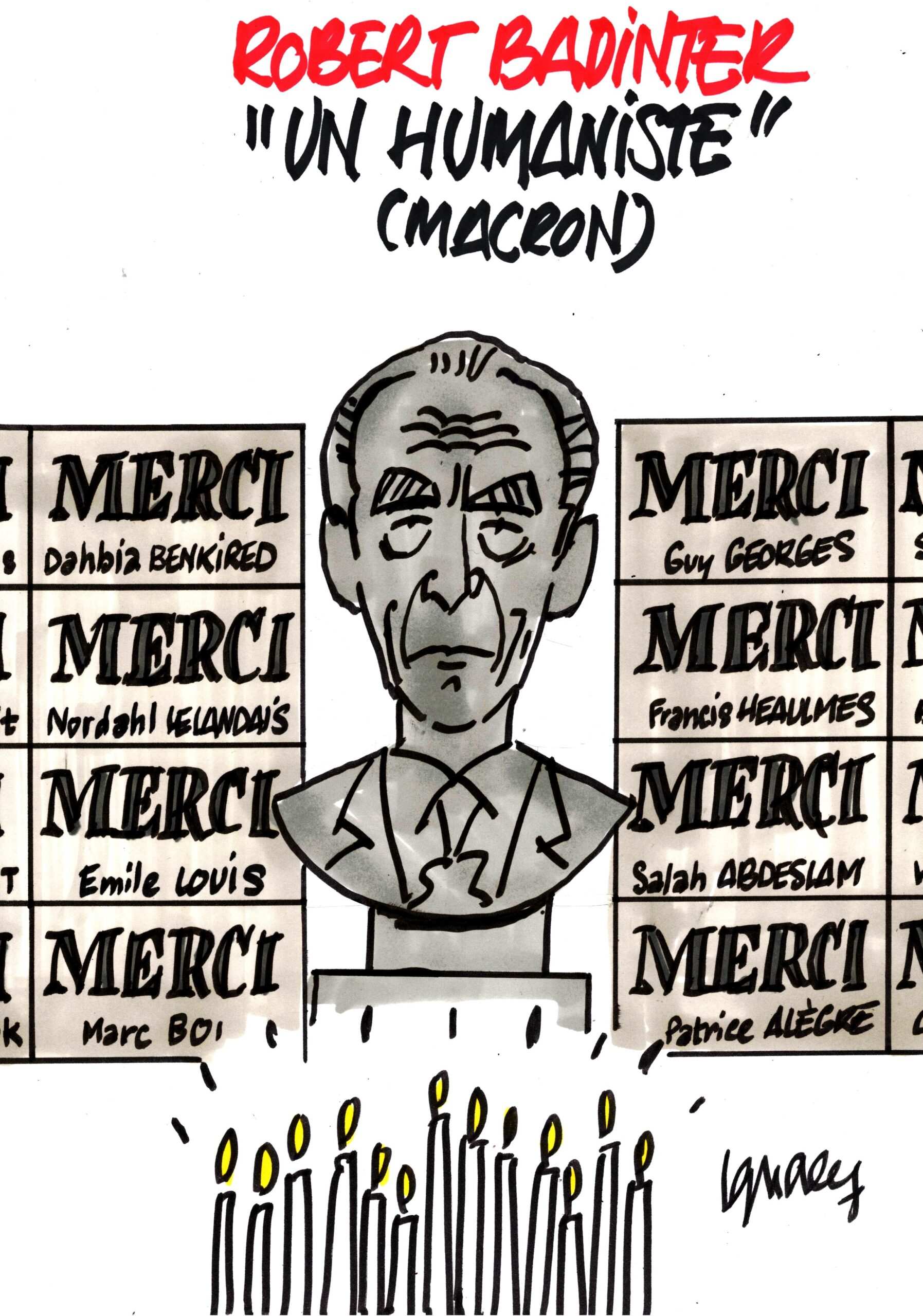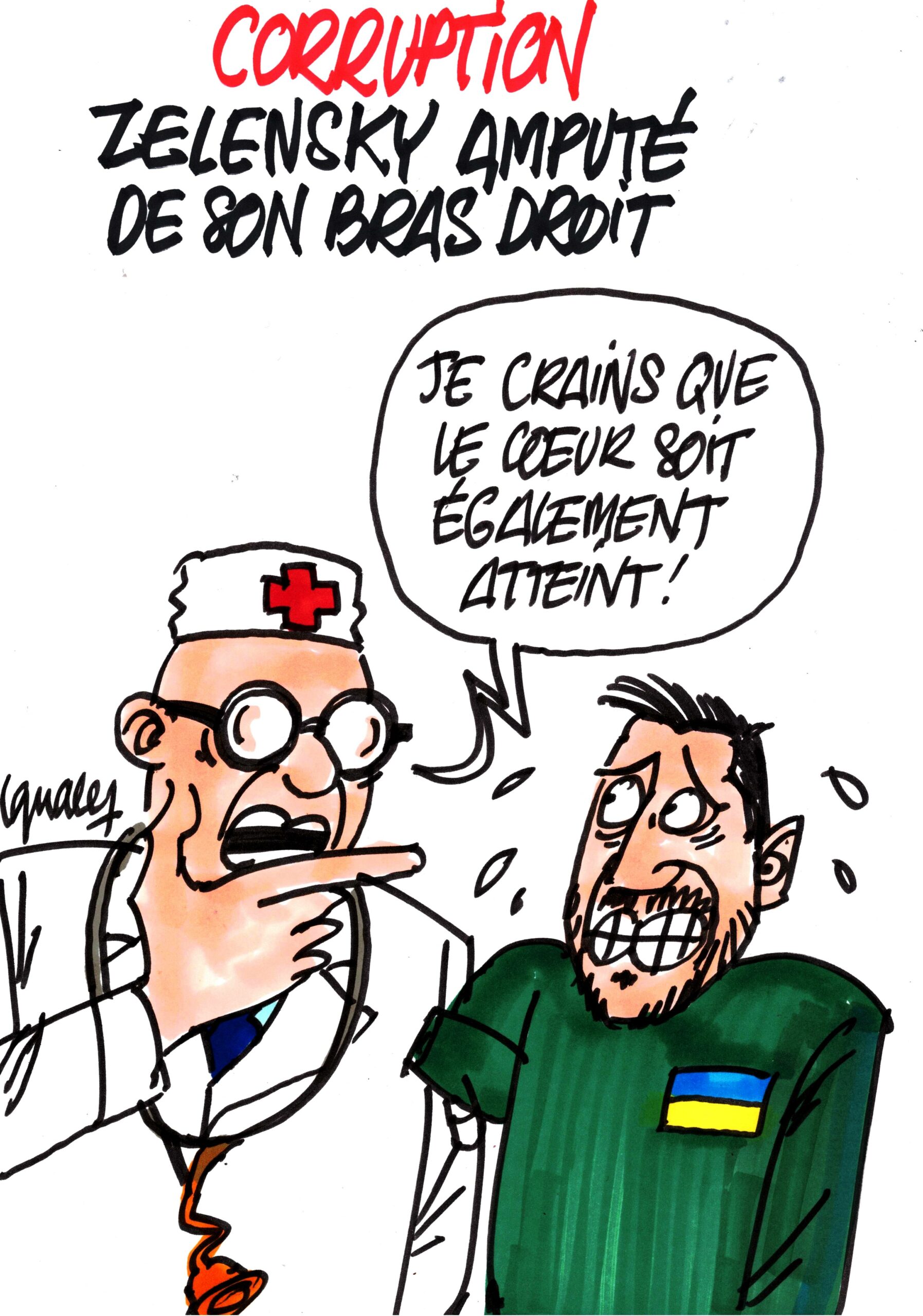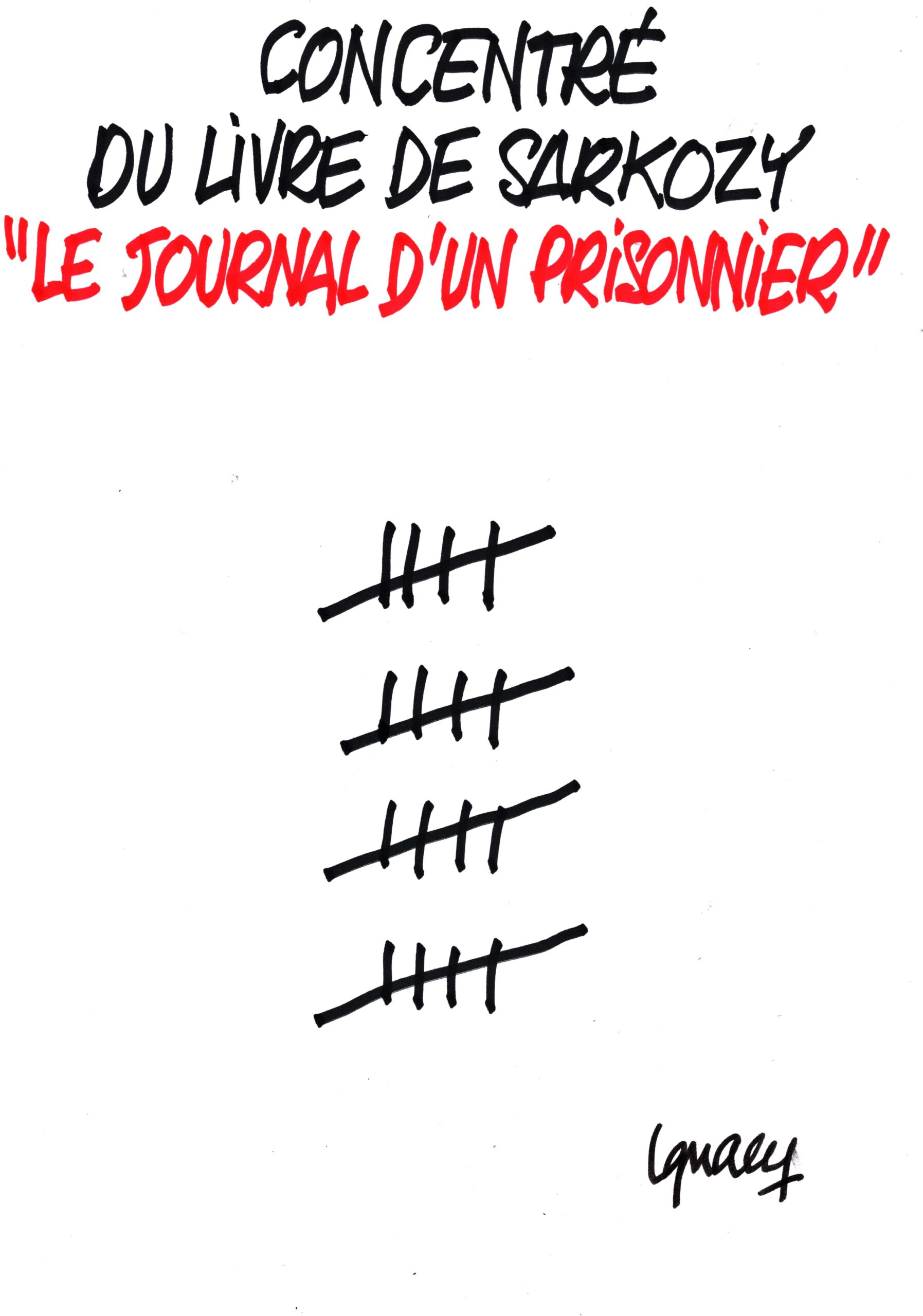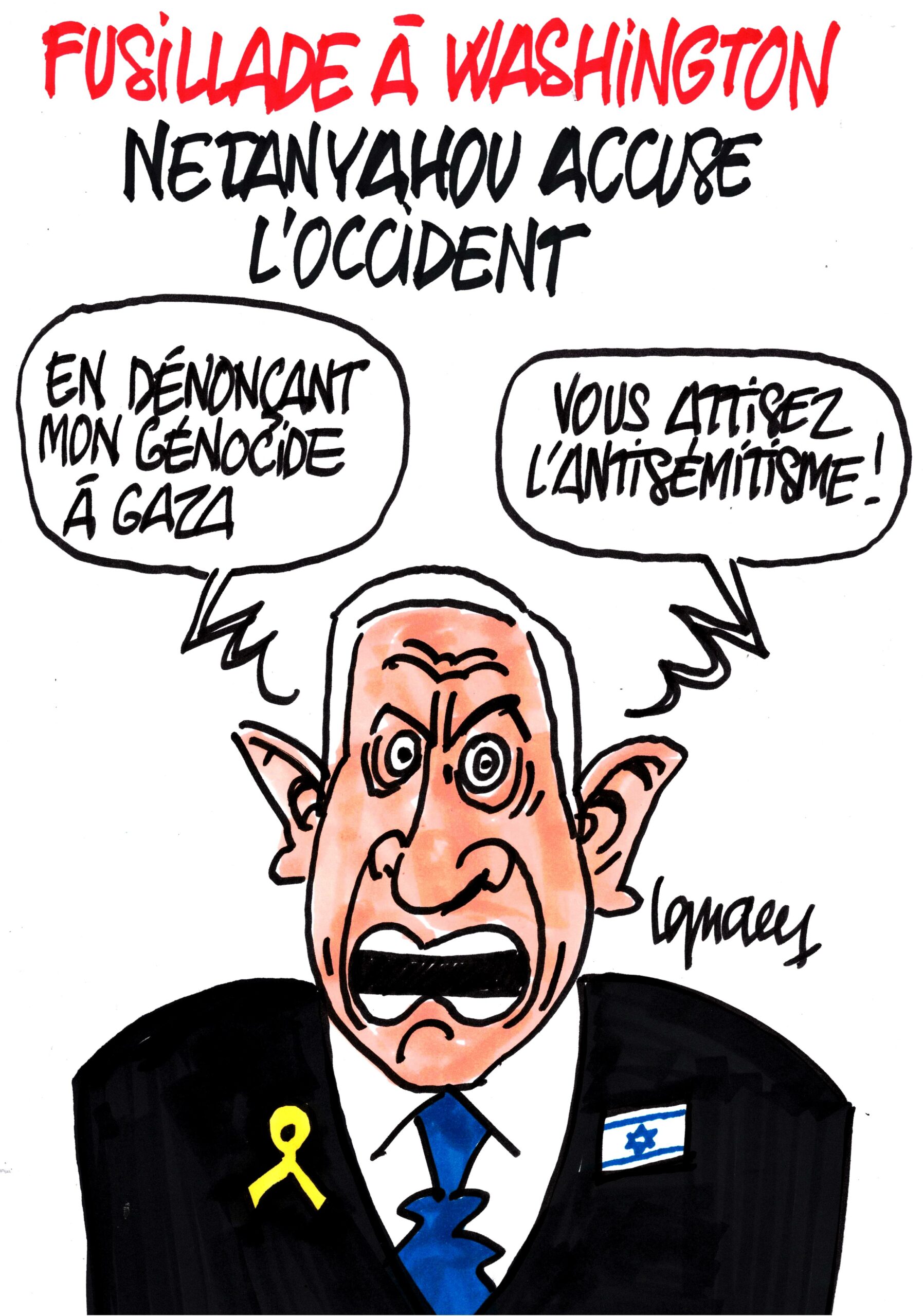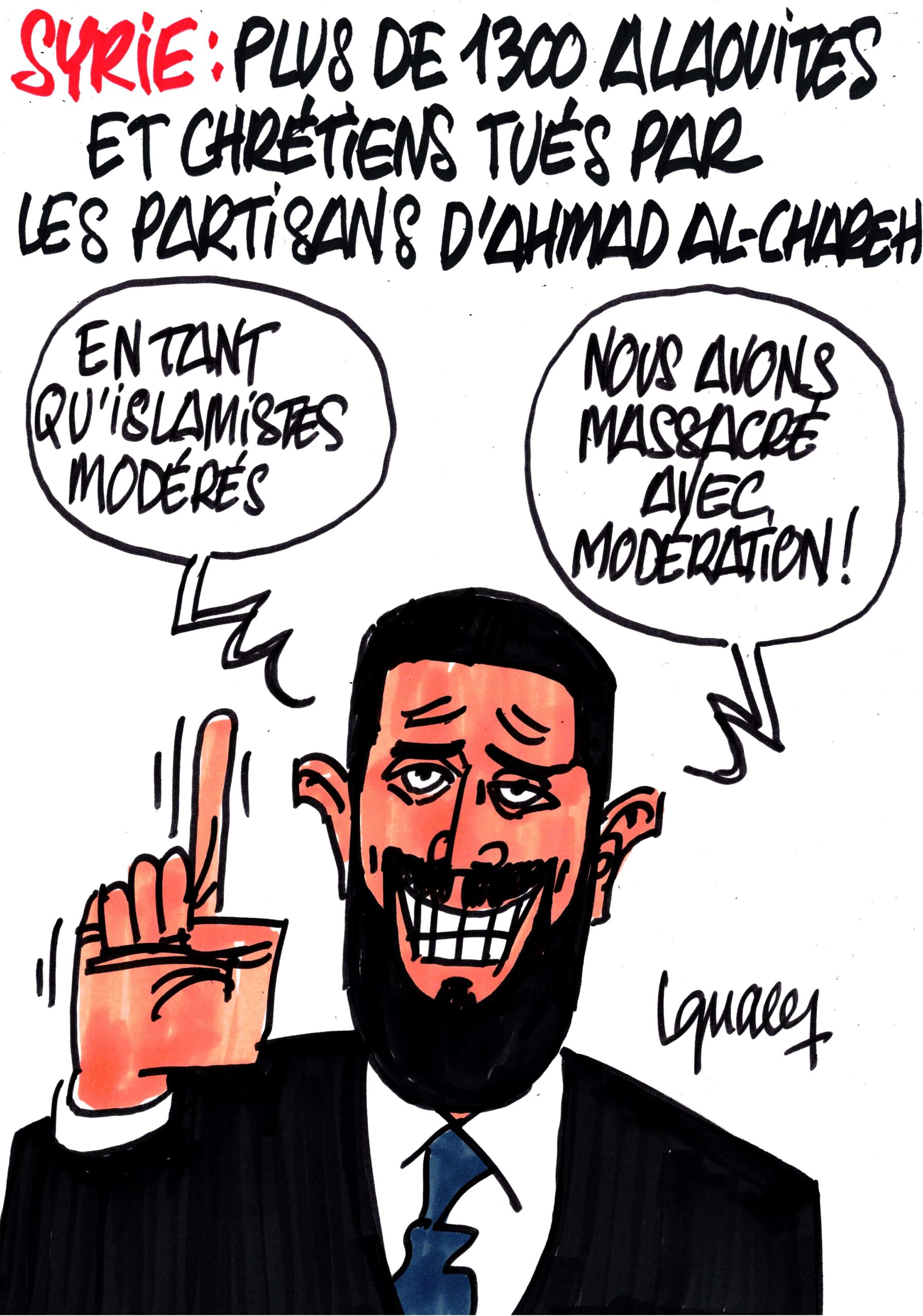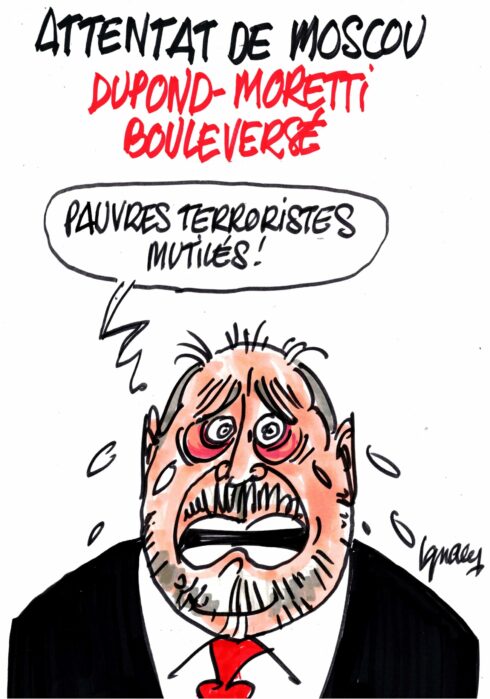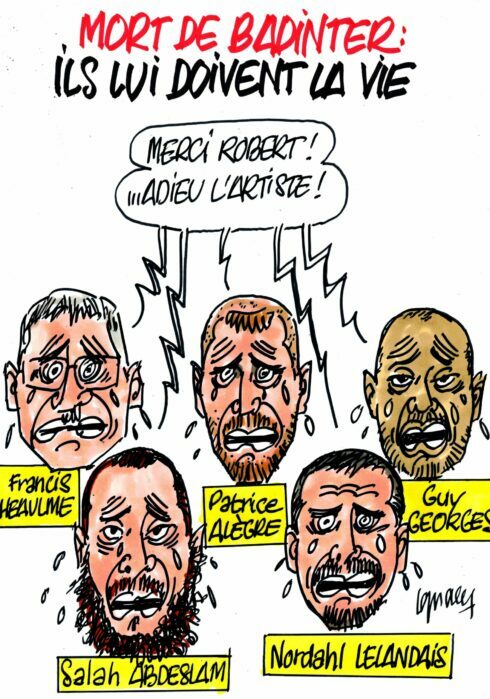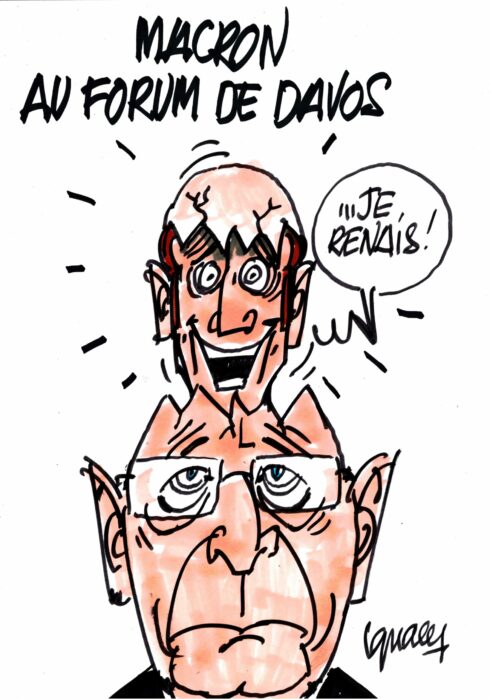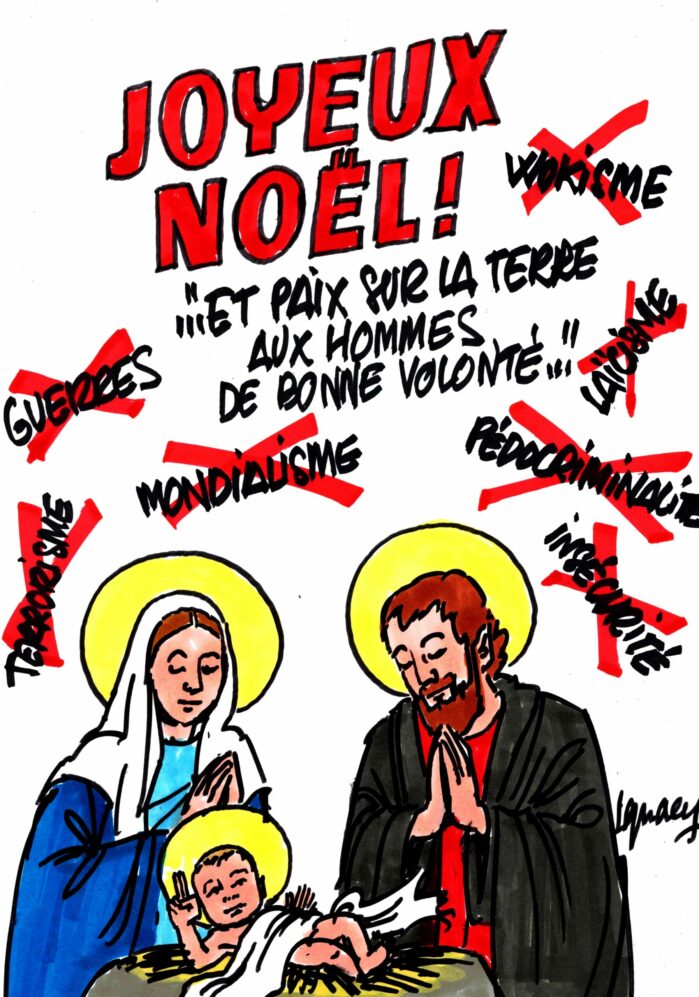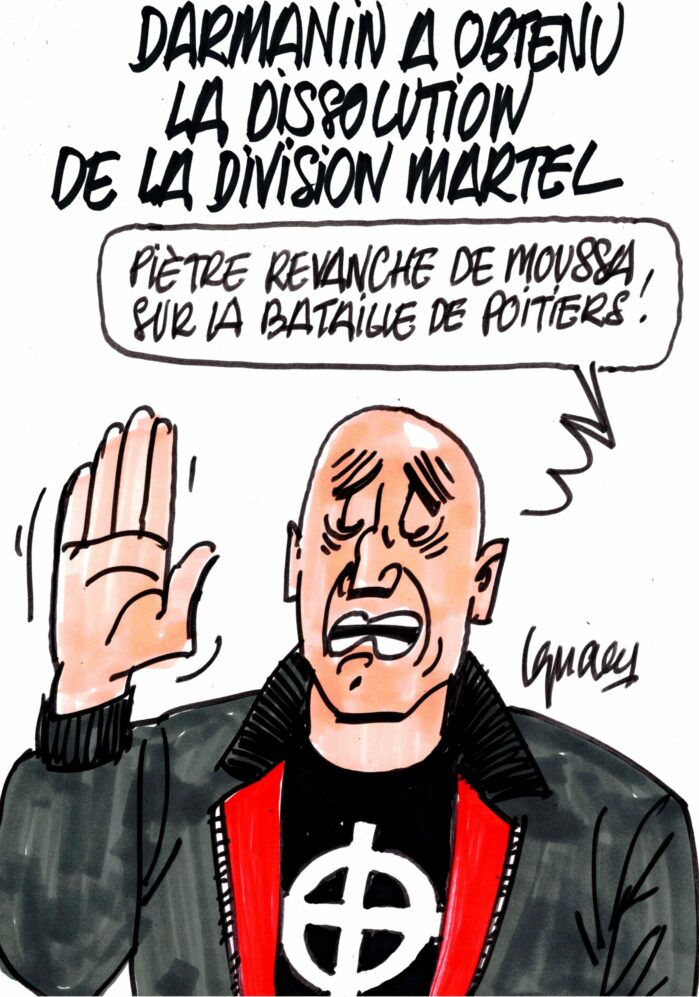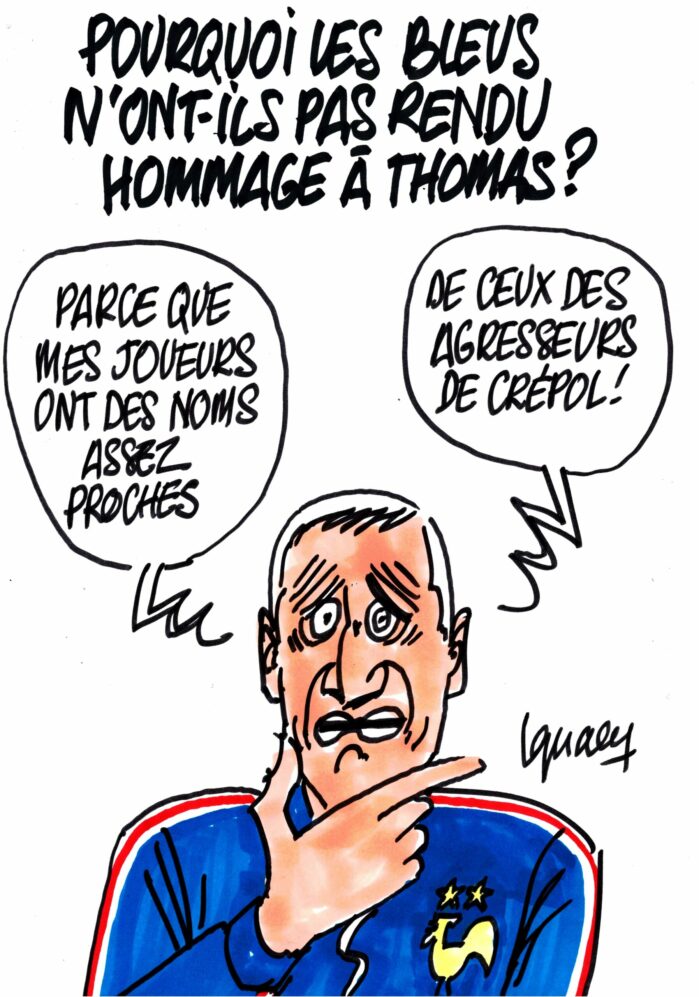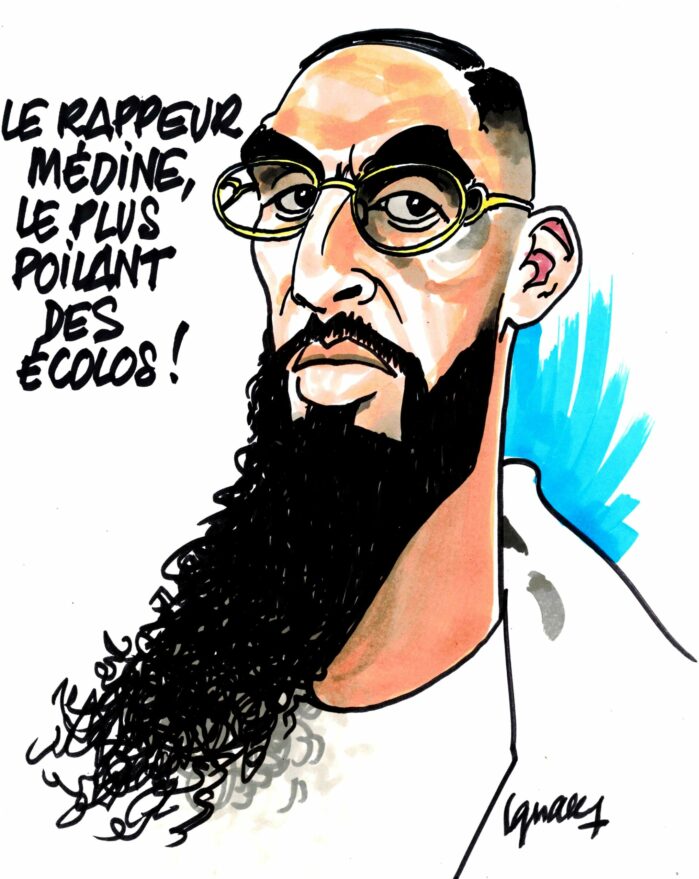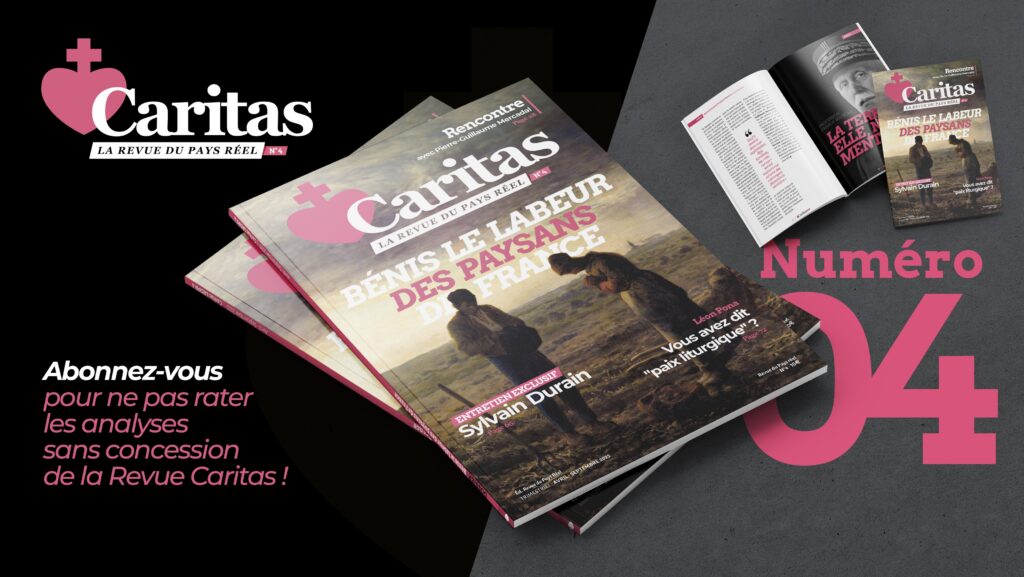Professeur d’histoire médiévale à l’ENS-LSH de Lyon, Sylvain Gouguenheim, spécialiste des chevaliers Teutoniques, est aussi l’auteur d’essais historiques sur le Moyen Âge. Pour le présent ouvrage, il a réuni une équipe d’historiens éminents afin de présenter les vingt principaux empires médiévaux.
La période médiévale, dont les bornes sont ici étendues à la planète entière, se caractérise par l’apparition de constructions politico-religieuses qui diffèrent des empires de l’Antiquité dite « tardive » (empire chrétien romain de Constantinople, premier empire islamique, Chine des Tang accueillant le bouddhisme, empire mongol longtemps animiste avant de passer à l’islam…).
Cette association du politique et du religieux est sensible chez les Carolingiens, les Aztèques, en Islam et chez les Mongols.
Empires et « systèmes-mondes »
Les empires antiques (Mésopotamie, Perse, Rome, Chine des Han) formaient de vastes systèmes-mondes autonomes. L’Europe médiévale a rompu avec ce modèle : les empires carolingien puis germanique, soucieux de restaurer celui de Rome, n’en furent qu’un modèle réduit et inachevé. L’Europe s’est développée selon un schéma multipolaire. Les « empires-mondes » les plus efficaces doivent être cherchés hors de l’Europe latine : à l’abri incertain de la Grande Muraille de Chine, à Constantinople, au Japon, chez les Incas, voire en Ethiopie et, bien sûr, chez les Mongols, dont la construction fut toutefois victime d’une fragmentation rapide.
Enfin, la période médiévale met en scène des passations de pouvoir entre empires : affaibli par ses querelles internes et par les coups de boutoir répétés de ses agresseurs (Arabes, Bulgares, Pétchenègues), Byzance, qui se pensait comme la perpétuation de Rome, connut ce à quoi Rome n’avait pas été confrontée : la montée en force d’un empire rival, le califat des Abbassides, si puissant qu’il bâtit un système-monde nouveau, dont Constantinople n’était plus qu’une périphérie, en voie d’absorption ; l’hégémonie grecque n’étant plus que régionale et subalterne.
Tout empire est pluriethnique
Si tous les empires ne prétendent pas à l’universalisme, tous (à l’exception du Japon cantonné par son insularité) sont le fruit d’acquisitions extérieures, donc de l’extension d’un centre au-delà de ses frontières originelles. Ce faisant, tout empire devient pluriethnique, multiculturel et se confronte à l’hétérogénéité des populations qui le composent.
Les diverses formes de la fin des empires
Cette fin des empires relève de leur incapacité à rendre étanches leurs frontières, à contrôler les forces centrifuges, à préserver leur légitimité par leurs constructions idéologiques ou monumentales, leur décorum et leurs rituels, à maintenir au pouvoir une famille ou une élite suffisamment puissante. Les empires disparaissent aussi pour avoir failli à leur mission, à leurs prétentions affichées d’imposer la paix et l’ordre là où régnait le chaos…
Tour d’horizon planétaire
Ce livre passionnant d’histoire comparée nous entraîne dans les Empires carolingien, byzantin, abbasside, mongol et ottoman, en Chine, en Khazarie, dans les Empires bulgare, serbe, latin de Constantinople, au Japon médiéval, dans les Empires solaires des Amériques, au royaume chrétien d’Ethiopie, dans l’Empire allemand et celui des Normands, dans les trajectoires impériales en Adriatique et à Srivijaya, thalassocratie malaise, sans oublier l’empire Plantagenêt.
Ex Libris
Les Empires médiévaux, ouvrage collectif sous la direction de Sylvain Gouguenheim, éditions Perrin, 464 pages, 25 euros
A commander en ligne sur le site de l’éditeur
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !