« L’EoF est bien l’économie du pape François ; elle n’est pas celle de saint François. »
En vue de « ré-animer l’économie », le pape François a invité « les jeunes économistes, entrepreneurs et entrepreneuses du monde entier » à entrer dans un processus de réforme économique, placé sous le patronage de saint François d’Assise. Dans la Chronique précédente, nous nous étions penché sur l’économie de saint François et avions conclu que, si le Séraphin d’Assise ne s’est nullement occupé de science économique, il a cependant solutionné, indirectement, bien des problèmes économiques, en exhortant efficacement les chrétiens à vivre de la grâce du Christ et de son Évangile. Reste à considérer maintenant quelle réforme économique promeut le pape François. Nous serons alors en mesure de dire si cette réforme peut légitimement se réclamer du patronage de saint François, et si elle est en mesure de produire des fruits durables de paix sociale et de prospérité économique.
II – L’économie du pape François
Trois choses interpellent le lecteur averti qui prend connaissance des documents issus de processus EoF (Economy of Francesco) : le non-recours à la doctrine sociale de l’Église ; l’absence de référence au Christ et à l’ordre surnaturel ; l’omniprésence de l’idéologie écologique.
1 – L’économie du pape François ne recourt pas à la doctrine sociale de l’Église
Après avoir rappelé ce qu’est la doctrine sociale de l’Église, nous montrerons que le pape François ne s’y réfère pas ; d’où la fragilité de son enseignement.
Ce qu’est la doctrine sociale
La doctrine sociale de l’Église est l’enseignement pontifical en matière sociale. Cet enseignement constitue une doctrine ; le pape, transmettant cette doctrine, ne parle pas seulement comme Pasteur, mais encore comme Docteur. Le pasteur veille, par sa prudence, à ce que les brebis ne s’égarent pas dans des chemins dangereux ; le docteur enseigne avec autorité. Or le pape jouit de cette autorité de docteur non seulement pour transmettre fidèlement et interpréter correctement le dépôt des vérités divinement révélées, mais encore pour rappeler les vérités de l’ordre naturel et défendre la conception raisonnable de la vie humaine, qui ne peut atteindre sa fin dernière qu’à la condition d’être restaurée et surélevée par la grâce divine.
Cette doctrine possède trois caractéristiques : d’abord, elle est une synthèse spéculative, un résumé des principes de l’ordre social ; ensuite, elle possède une portée pratique, en tant qu’elle vise à diriger les actions de l’homme vivant en société dans les domaines les plus divers (la famille, le métier, l’entreprise, la nation, etc.) ; enfin, elle implique une obligation morale.
La doctrine sociale de l’Église est dite « catholique » en deux sens. Premièrement, en ce qu’elle a une portée universelle (c’est la signification étymologique du mot catholique) : nous affirmons par là que les exigences morales qui inspirent cette doctrine sont valables pour tous les hommes de tous les temps. Deuxièmement, en ce sens que c’est une doctrine religieuse. En effet, ce ne sont pas seulement les exigences de la morale et du droit naturels qui servent de fondement à la doctrine sociale de l’Église. Le Christ n’est pas une idée abstraite, Dieu n’est pas un concept. Et c’est pour cela que la doctrine sociale se fonde aussi sur l’Évangile et qu’elle appelle, pour être reçue et réalisée, un acte de foi surnaturelle et le secours de la grâce divine.
Le pape Pie XI explique clairement de quel droit l’Église intervient dans les questions économiques et sociales : « Sans doute, c’est à l’éternelle félicité et non pas à une prospérité passagère seulement que l’Église a reçu la mission de conduire l’humanité ; et même, elle ne se reconnaît point le droit de s’immiscer sans raison dans la conduite des affaires temporelles. À aucun prix toutefois elle ne peut abdiquer la charge que Dieu lui a confiée et qui lui fait une loi d’intervenir, non certes dans le domaine technique, à l’égard duquel elle est dépourvue de moyens appropriés et de compétence, mais en tout ce qui touche à la loi morale. En ces matières, en effet, le dépôt de la vérité qui nous est confié d’en haut et la très grave obligation qui nous incombe de promulguer, d’interpréter et de prêcher, en dépit de tout, la loi morale, soumettent également à notre suprême autorité l’ordre social et l’ordre économique. Car, s’il est vrai que la science économique et la discipline des moeurs relèvent, chacun dans sa sphère, de principes propres, il y aurait néanmoins erreur à affirmer que l’ordre économique et l’ordre moral sont si éloignés l’un de l’autre, si étrangers l’un à l’autre, que le premier ne dépend en aucune manière du second (1). » Et Pie XII affirme dans le même sens que l’Église n’entend pas « fixer des règles sur le terrain purement pratique, technique peut-on dire, de l’organisation sociale », mais qu’« incontestable, en revanche, est la compétence de l’Église dans cette part de l’ordre social qui entre en contact avec la morale, pour juger si les bases d’une organisation sociale donnée sont conformes à l’ordre immuable des choses que Dieu a manifestées par le droit naturel et la révélation. (…) De la forme donnée à la société, en harmonie ou non avec les lois divines, dépend ou s’infiltre le bien ou le mal des âmes (2). »
On ne peut fonder d’organisation sociale, économique, politique sur des considérations uniquement techniques ; aussi, l’Église a son mot à dire, et elle le dit en enseignant sa doctrine. Malheureusement, le pape François n’en parle pas.
Le pape François ne s’y réfère pas.
Il est remarquable que le souverain pontife, lors de ses interventions dans le cadre EoF, ne se réfère jamais à la doctrine sociale de l’Église, même post-conciliaire. C’est que, dans la pensée de François, la doctrine fige la vie, les principes freinent la marche. Certes, le pape exhorte les acteurs économiques à pratiquer la justice et la charité, mais sans indiquer l’objet de ces vertus, sans recourir aux principes intangibles de la loi naturelle et, comme nous le dirons plus loin, sans se référer à Dieu et à l’ordre surnaturel.
Si le pape ne transmet plus l’enseignement doctrinal de l’Église, que fait-il ? Il encourage au dialogue, à un dialogue déconnecté de la vérité objective ; quant à lui, il écoute toutes ces voix discordantes comme autant de témoignages « prophétiques », qui indiquent ce que l’Esprit-Saint dit à l’Église. En d’autres termes, une même conception soudent l’EoF et la synodalité
actuelle : dans les deux cas, la lumière jaillit du conflit, de la confrontation des idées, grâce à une écoute qui ne juge pas mais recherche le consensus. Voici ce que dit François aux participants du premier évènement EoF, en 2020 ; on pense inévitablement à la fameuse méthode synodale de la « conversation dans l’Esprit (3) » : « Permettez-moi de relever un exercice que vous avez expérimenté comme méthodologie pour une résolution des conflits saine et révolutionnaire. Durant ces mois, (…) vous avez été capables de vous rencontrer sur douze thématiques, (…) pour débattre, discuter, et identifier des voies praticables. Vous avez vécu la culture de la rencontre si nécessaire qui est le contraire de la culture du rejet qui est à la mode. Et cette culture de la rencontre permet à beaucoup de voix d’être autour d’une même table pour dialoguer, penser, discuter et créer, selon une perspective polyédrique, les différentes dimensions et réponses aux problèmes globaux qui concernent nos peuples et nos démocraties. Comme cela est difficile de progresser vers des solutions réelles quand on discrédite, calomnie et décontextualise l’interlocuteur qui ne pense pas comme nous ! Cette façon de discréditer, calomnier ou décontextualiser l’interlocuteur qui ne pense pas comme nous est une façon de se défendre lâchement contre les décisions que je devrais assumer pour résoudre beaucoup de problèmes. N’oublions jamais que « le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de celles-ci (4) ». » (5) On est en plein subjectivisme ; le pape François applique ici aux domaines social et économique les principes de l’oecuménisme et du dialogue interreligieux.
Inanité des exhortations romaines
Une invitation vague à la justice, à la charité, au respect, fondée, non sur la doctrine immuable de l’Église, mais sur le sentiment et sur la dignité mal comprise de la personne humaine, ne peut conduire à des résultats solides et durables. Seule l’application de la doctrine sociale de l’Église est capable de produire des fruits abondants. Voici ce qu’affirme Léon XIII au sujet de la question ouvrière : « C’est l’Église, en effet, qui puise dans l’Évangile des doctrines capables, soit de mettre fin au conflit, soit au moins de l’adoucir, en lui enlevant tout ce qu’il a d’âpreté et d’aigreur ; l’Église, qui ne se contente pas d’éclairer l’esprit de ses enseignements, mais s’efforce encore de régler en conséquence la vie et les moeurs de chacun ; l’Église, qui, par une foule d’institutions éminemment bienfaisantes, tend à améliorer le sort des classes pauvres ; l’Église, qui veut et désire ardemment que toutes les classes mettent en commun leurs lumières et leurs forces, pour donner à la question ouvrière la meilleure solution possible ; l’Église enfin, qui estime que les lois et l’autorité publique doivent, avec mesure et avec sagesse sans doute, apporter à cette solution leur part de concours (6) .» Au contraire, en omettant d’enseigner la saine doctrine, le pape actuel se condamne à ne prononcer que des paroles creuses et inefficaces. D’autant plus que ces paroles sont imprégnées de naturalisme.
2 – L’économie du pape François est fondée sur l’erreur du naturalisme
Un enseignement naturaliste
Le naturalisme est l’erreur qui prétend tout réduire à la nature, à ses forces, à ses lois ; il est la négation théorique ou pratique (ou les deux à la fois) de l’ordre surnaturel. Exposer des réalités naturelles intimement liées à l’ordre surnaturel sans évoquer Dieu, le Christ, sa loi, sa grâce, est la marque certaine de l’hérésie naturaliste. Or, l’économie fait partie de ces réalités, et les réformes de l’EoF ne se réfèrent nullement aux richesses apportées par la seule religion révélée, le christianisme.
L’évangile que l’homme, selon l’EoF, doit prêcher et promouvoir ne sort pas des sphères de l’ordre naturel : « La perspective du développement humain intégral, dit François, est une bonne nouvelle (c’est-à-dire un évangile) qu’il faut prophétiser et réaliser, parce qu’elle nous propose de nous retrouver comme humanité sur la base du meilleur de nous-même (7). » Et un peu plus loin : « N’ayez pas peur (de la crise économique et écologique), parce que personne ne se sauve tout seul (8). » Le salut dont il est question ne relève certainement pas de l’ordre de la grâce et de Jésus-Christ son auteur… Le « Pacte pour l’économie », conclu le 24 septembre 2022 entre les jeunes économistes et le pape François, vise à promouvoir « une économie sur l’Évangile ». Or, les moyens proposés n’ont aucun lien avec l’ordre surnaturel.
Contradiction avec le magistère catholique
C’est un enseignement constant du magistère que l’ordre et la paix, même simplement naturels, ne peuvent être obtenus sans la promotion de l’ordre surnaturel. Citons par exemple l’encyclique Ubi Arcano Dei de Pie XI sur « la paix du Christ par le règne du Christ » (1922) : « Il ne saurait y avoir aucune paix véritable – cette paix du Christ si désirée – tant que tous les hommes ne suivront pas fidèlement les enseignements, les préceptes et les exemples du Christ, dans le domaine de la vie publique comme dans celui de la vie privée. » Seul le règne du Christ apportera la santé au corps social et la paix aux esprits. Et ailleurs, le même pape affirme que l’union, source de paix, ne peut se réaliser que dans le Christ : « Une vraie collaboration de tous en vue du bien commun ne s’établira que lorsque tous auront l’intime conviction d’être les membres d’une grande famille et les enfants d’un même Père céleste, de ne former même dans le Christ qu’un seul corps dont ils sont réciproquement les membres, en sorte que si l’un souffre, tous souffrent avec lui (9). » C’est en Dieu et dans le Christ que la justice et la charité véritables prennent leurs racines et portent des fruits durables.
D’après l’enseignement constant du magistère, il apparaît clairement qu’il n’y a d’ordre et de paix que par le règne du Christ, et que le moyen le plus efficace et le seul absolument nécessaire pour rétablir cet ordre et cette paix est de restaurer le règne du Christ.
Irréalisme de l’économie du pape François
Mais puisque le « magistère » actuel ne se réfère plus à l’ordre surnaturel en matière économique et sociale, puisqu’il ne prend pas en compte le péché originel et la grâce qui en restreint les conséquences, sa prédication, déjà creuse et fragile par l’absence de doctrine solide (10), est encore irréaliste, ne prenant pas en compte la situation concrète dans laquelle tout homme se trouve placé.
Et que l’on ne dise pas qu’il importe de s’occuper de l’homme avant de s’occuper de la religion ; car on ne peut séparer ce que Dieu a uni, on ne peut séparer la nature et la grâce, appelées à une intime collaboration, tant sur le plan individuel que sur le plan social : « Ils se trompent ces catholiques promoteurs d’un nouvel ordre social qui soutiennent : » Tout d’abord la réforme sociale, puis on s’occupera de la vie religieuse et morale des individus et des sociétés. » On ne peut en réalité séparer la première chose de la seconde, parce qu’on ne peut désunir ce monde de l’autre, ni diviser en deux parties l’homme qui est un tout vivant10. » Mettant entre parenthèses l’ordre surnaturel, l’économie promue par François se condamne à n’être qu’une utopie.
3 – L’économie du pape François est imprégnée de l’idéologie écologique (11)
Un dernier élément frappe l’esprit à la lecture des documents de l’EoF : les préoccupations d’ordre écologique.
L’idéologie écologique
L’écologie, ou l’étude des milieux dans lesquels évoluent les êtres vivants, est depuis plusieurs décennies instrumentalisée par les courants et les mouvements mondialistes, en vue de préparer l’avènement d’un gouvernement et d’une religion mondials. Selon l’idéologie écologique actuelle, la nature ou la terre est un tout animé et divin. L’être humain est en interaction continuelle avec ce tout, dont il est une partie comme les autres, nullement supérieure en dignité. L’univers n’est pas hiérarchisé, la nature n’est pas subordonnée à l’homme, tout comme l’homme n’est pas subordonné à Dieu, puisque l’univers lui-même est une réalité divine et autonome.
On voit que la pensée chrétienne, fondée sur les dogmes de la création, de la distinction réelle entre Dieu et ses créatures, ainsi que de la subordination de la nature à l’homme et de l’homme à Dieu, représente un obstacle majeur à l’expansion de l’idéologie écologique. Aussi cette dernière prêche-t-elle un « changement de paradigme », un abandon de la vision judéo-chrétienne du monde au profit d’une vision « globale » de l’univers, où tous les êtres sont interactifs et divinisés. À cette nouvelle croyance correspondra une nouvelle morale, selon laquelle le péché sera d’ordre écologique et consistera à refuser d’écouter le « cri de la terre », que ce cri provienne des êtres humains ou du monde naturel.
L’écologie du pape François
Malheureusement, le souverain pontife adhère au mouvement écologique dont nous venons de résumer la pensée profonde. Le 24 mai 2015, il a promulgué la lettre encyclique Laudato si, consacrée à ce thème. Dès le début, le pape souligne « l’urgence et la nécessité d’un changement presque radical de comportement de l’humanité » en matière écologique (n°4), changement qualifié de « conversion écologique globale » (n° 5). François invite à un changement de « paradigme », grâce à « un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité » (n°111). Certes, le pape n’avalise pas le paganisme écologique et son anti- christianisme foncier, mais il ne le combat pas, et il reconnaît la validité et les bienfaits du processus écologique en cours : « Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un long chemin, digne d’appréciation » ; François regrette seulement que ces efforts se soient trop souvent heurtés à l’indifférence (n°14).
Le 4 octobre 2023, le pape est revenu solennellement sur ce thème par l’Exhortation apostolique Laudate Deum. Il y affirme par exemple que « Dieu nous a unis si étroitement au monde qui nous entoure, que la désertification du sol est comme une maladie pour chacun ; et nous pouvons nous lamenter sur l’extinction d’une espèce comme si elle était une mutilation (n°68) ». Et le pape de conclure en ces termes : « J’invite chacun à accompagner ce chemin de réconciliation avec le monde qui nous accueille, et à l’embellir de sa contribution, car cet engagement concerne la dignité personnelle et les grandes valeurs. (n° 69) »
L’économie au service de l’écologie
Les événements EoF doivent permettre d’évoluer vers une économie différente, « qui prenne soin de la création sans la piller ». Cette évolution est « nécessaire pour le destin de toute la planète, notre maison commune, notre » soeur la Mère Terre « , comme l’appelle François dans son cantique de Frère Soleil (12) ».
Et ailleurs, le pape affirme dans le même sens : « Une nouvelle économie, inspirée par François d’Assise, peut et doit aujourd’hui être une économie amie de la terre. (…) Une économie qui se laisse inspirer par la dimension prophétique s’exprime aujourd’hui dans une vision nouvelle de l’environnement et de la terre. Nous devons aller à cette harmonie avec l’environnement, avec la terre. Nombreuses sont les personnes, les entreprises et les institutions qui entreprennent une conversion écologique. Il faut aller de l’avant sur cette voie et faire plus. Ce » plus « , vous le faites et vous le demandez à tout le monde. Il ne suffit pas de faire du maquillage, il faut remettre en cause le modèle de développement (13). »
Ainsi, dans la pensée du pape François et des promoteurs de l’EoF, l’économie doit se mettre à la remorque du mouvement écologique, et donc se soumettre à l’idéologie écologiste. Par ce biais, l’économie n’est plus appelée à recevoir les influences de l’Évangile et de l’ordre surnaturel. Elle doit se soumettre, non au Christ, mais à l’écologie ; le Christ ne doit plus régner sur les réalités économiques.
Le logo EoF se compose de la corde franciscaine munie de ses trois noeuds. Ceux-ci symbolisent en réalité le triple voeu de pauvreté, chasteté et obéissance. Dans la mesure où l’Évangile est observé et où les vertus chrétiennes sont pratiquées, l’économie prospère et apporte sa nécessaire contribution au bien commun.
Saint François, par l’exemple de sa vie évangélique et la prédication de la foi catholique, a réellement, bien qu’indirectement, contribué à la prospérité des peuples et à la paix sociale. Mais l’économie promue par le pape François ne suit pas ce programme ; elle ne repose pas sur la doctrine de l’Église, elle ne fait pas appel aux secours de l’ordre surnaturel, elle s’inféode à l’idéologie écologiste. Rien d’étonnant, par conséquent, à ce qu’elle ne porte pas de fruits sains et durables. Par ailleurs, elle ne peut nullement se réclamer du patronage du Poverello d’Assise. L’EoF est bien l’économie du pape François ; elle n’est pas celle de saint François.
Frère Cassien-Marie
Notes de bas de page
(1) Encyclique Quadragesimo anno.
(2) Radio-message du 1er juin 1941.
(3) Sur ce sujet, voir le Sel de la terre n° 126, article du RP Marie-Dominique O.P., Le Synode sur la synodalité, p. 112-113.
(4) Citation de l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium (2013), n° 74. Le principe rapporté est juste, mais il est interprété dans un sens évolutionniste et hégélien : la lumière jaillit de la confrontation, la vie naît du conflit. De plus, ces paroles laissent entendre que c’est le nombre qui fait la vérité.
(5) Message vidéo du pape François aux participants du forum EoF, novembre 2020.
(6) Encyclique Rerum novarum.
(7) Message vidéo du pape aux participants du forum EoF, nov. 2020.
(8) Ibidem.
(9) Encyclique Quadragesimo Anno.
(10) Pie XII, allocution du 14 mai 1953.
(11) Sur ce sujet, on pourra consulter la Chronique n° 3, février 2021.
(12) Lettre du 1er mai 2019.
(13) Discours du 24 septembre 2022.
Voir les précédentes chroniques :
– Chronique d’Assise n° 01 – Les capucins en guerre !
– Chronique d’Assise n° 02 – Trahi et défiguré depuis longtemps
– Chronique d’Assise n° 3 – L’Encyclique Laudato Si face à Saint François et la nature
– Chronique d’Assise n° 4 : Le véritable esprit de saint François, « homme très catholique »
– Chronique d’Assise n° 5 : « Saint François démocrate ? »
– Chronique d’Assise n° 6 : « L’économie de François » [Première partie]
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !



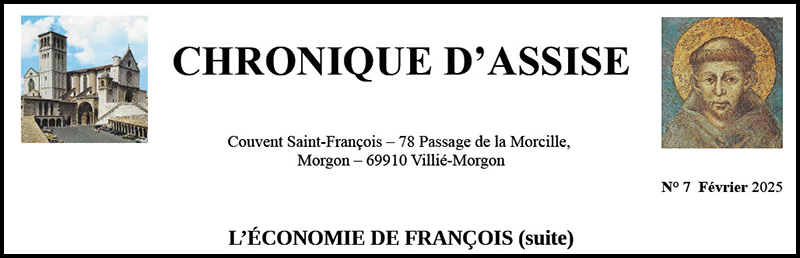





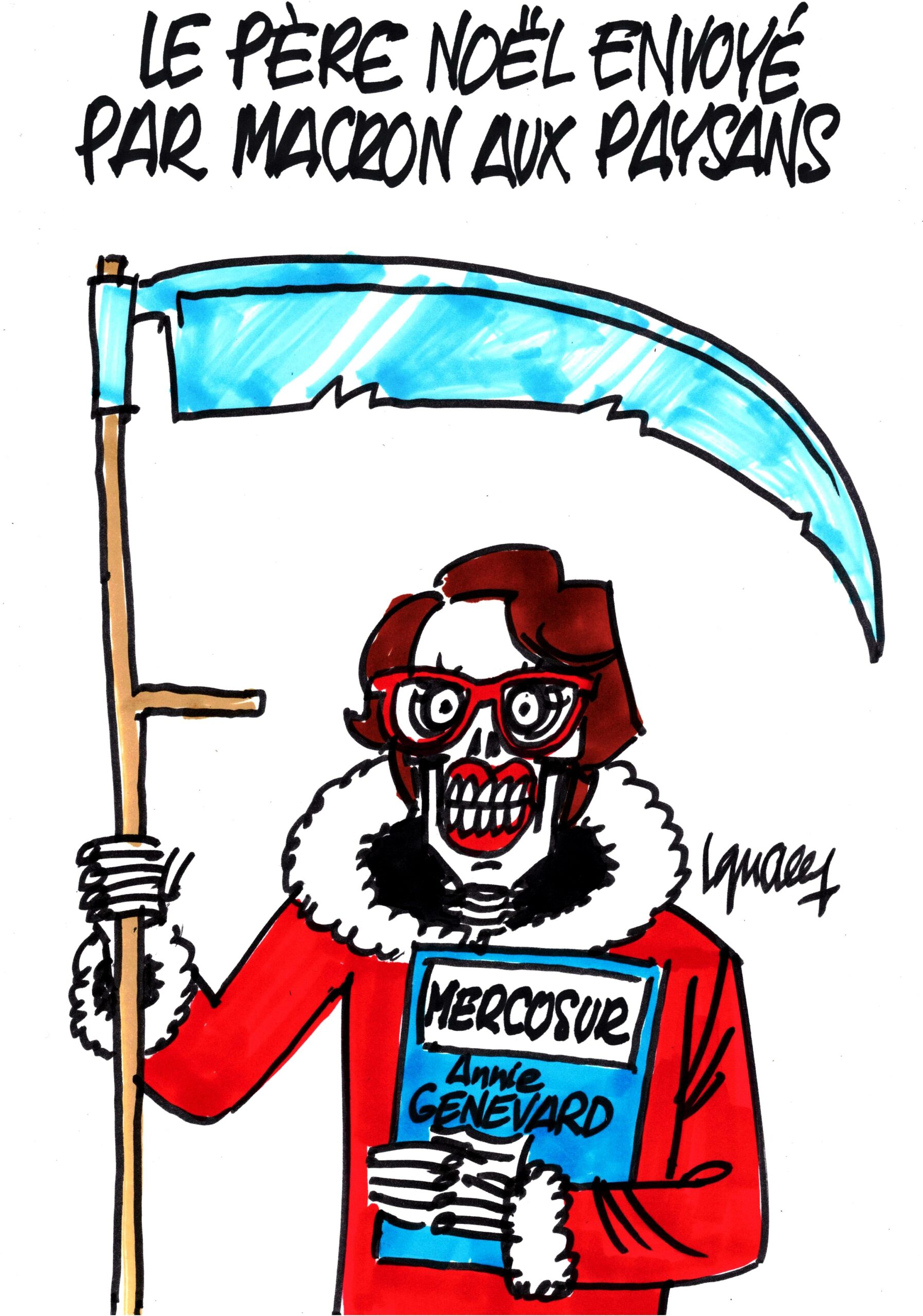



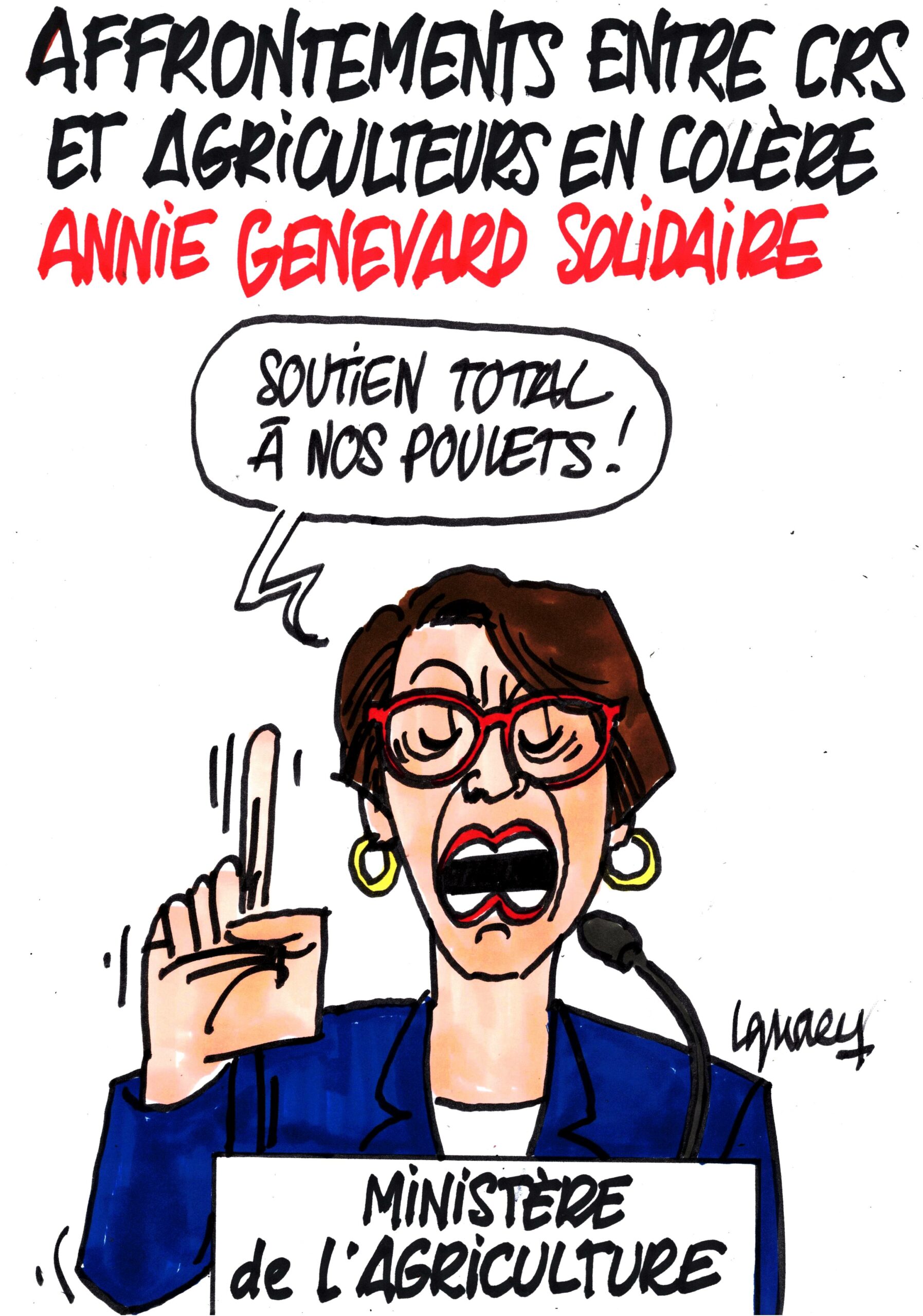
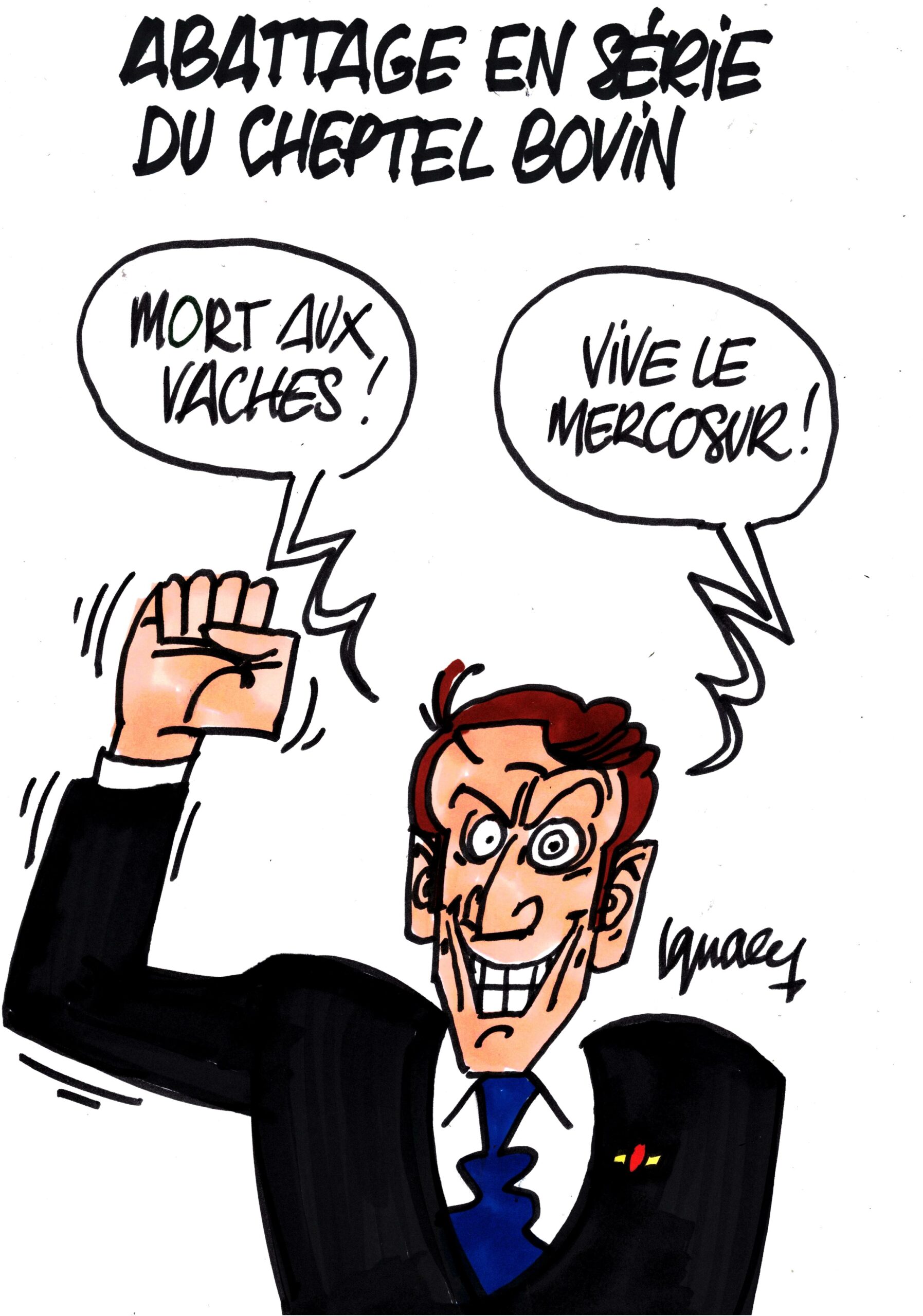




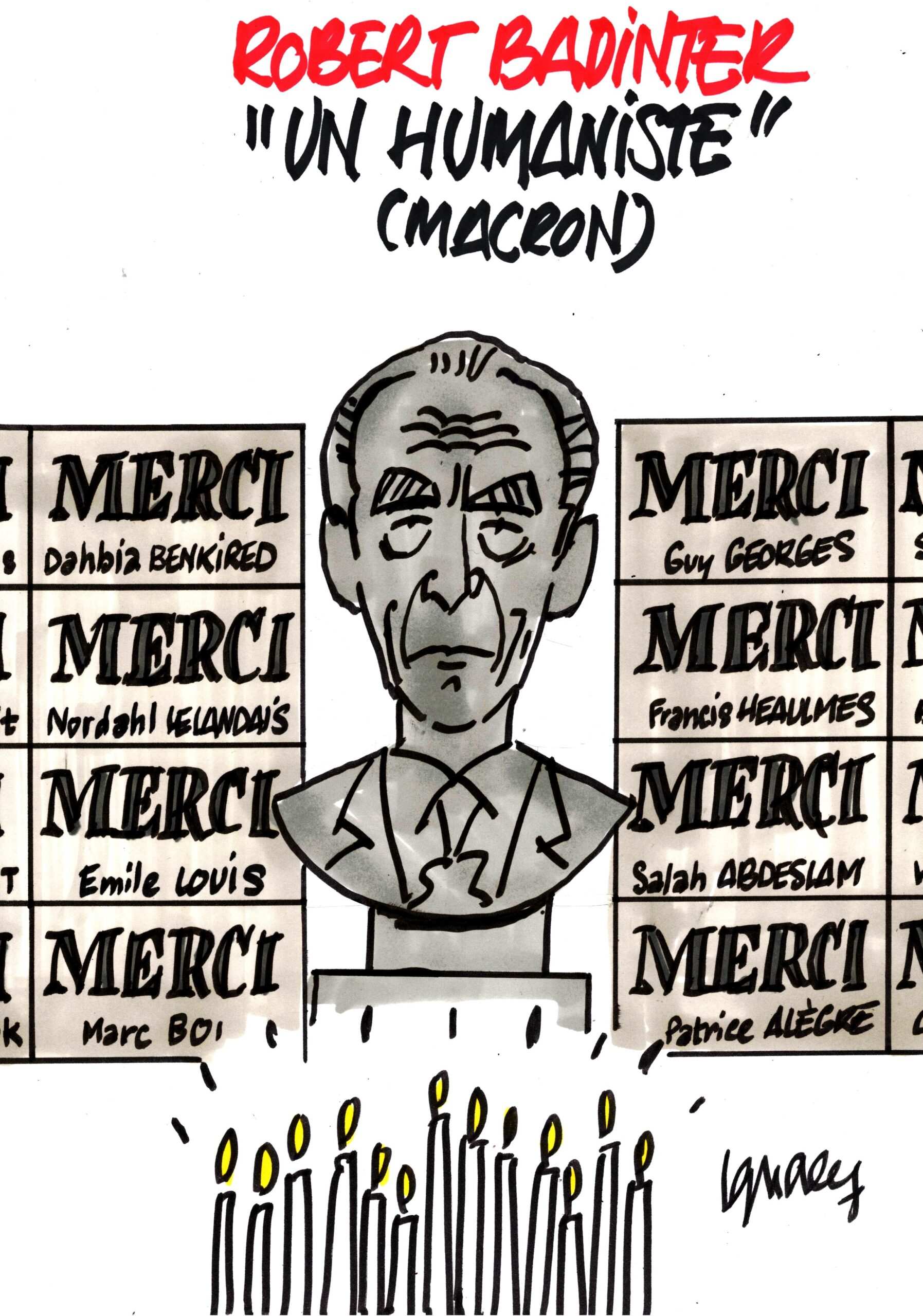







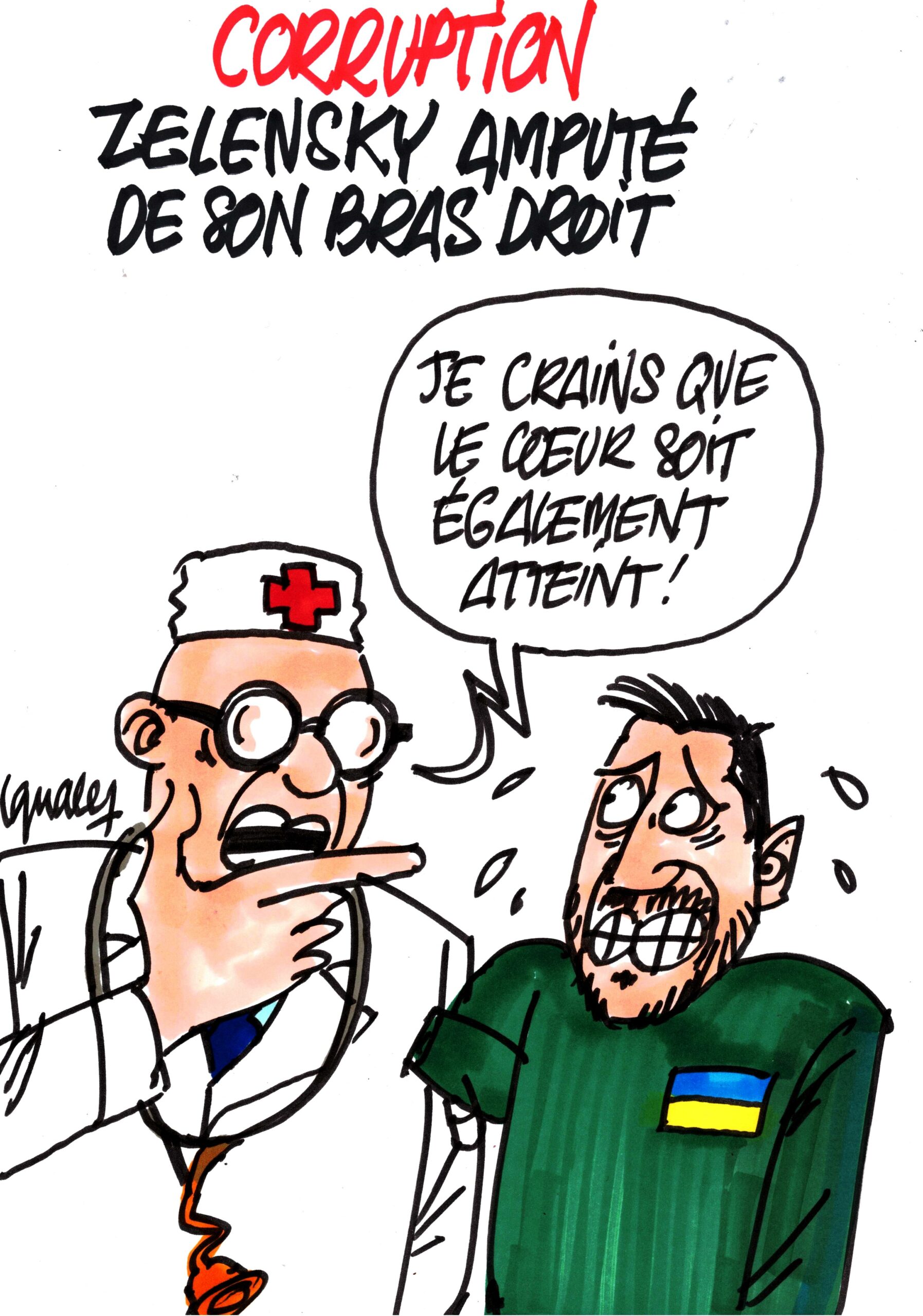
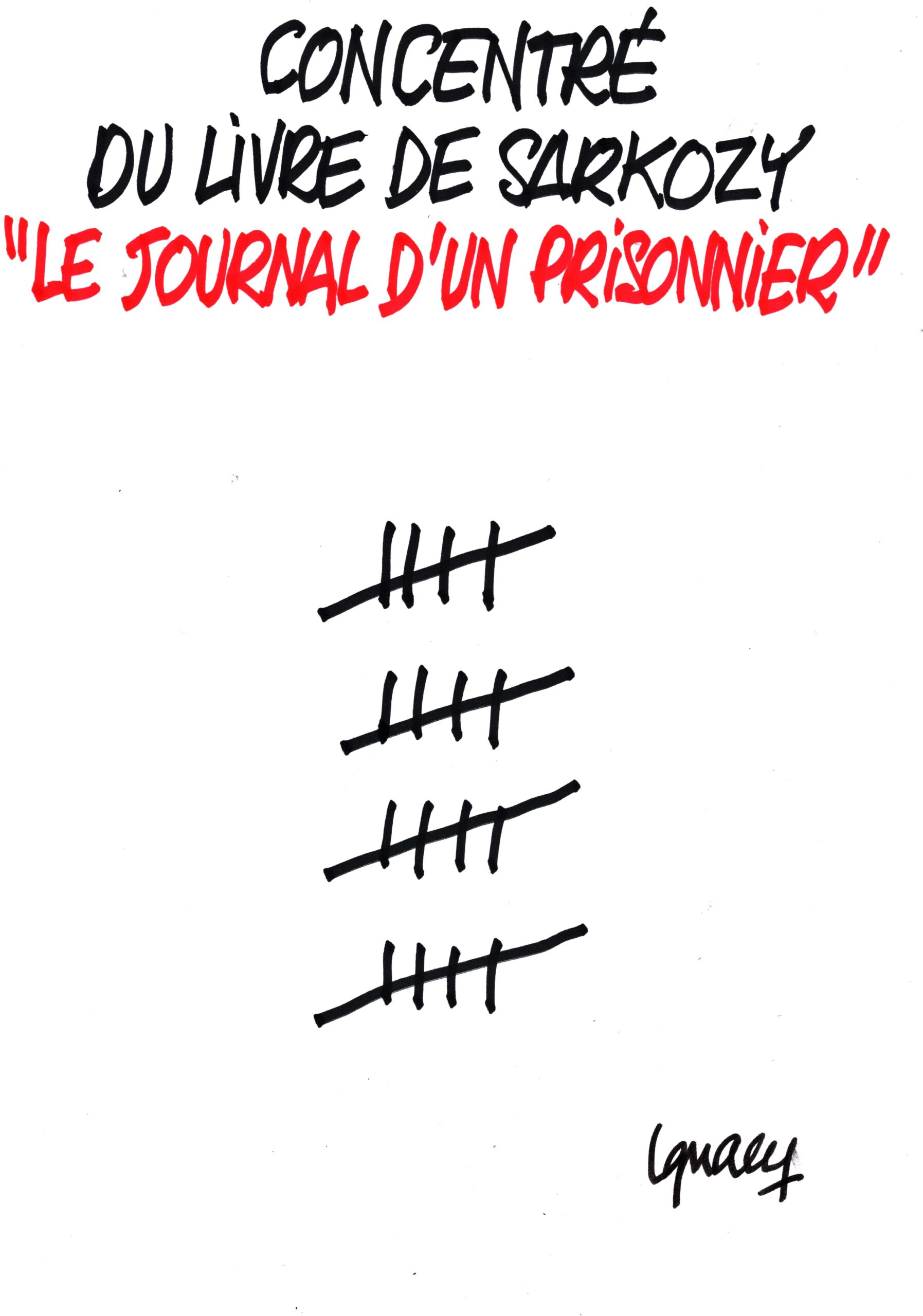









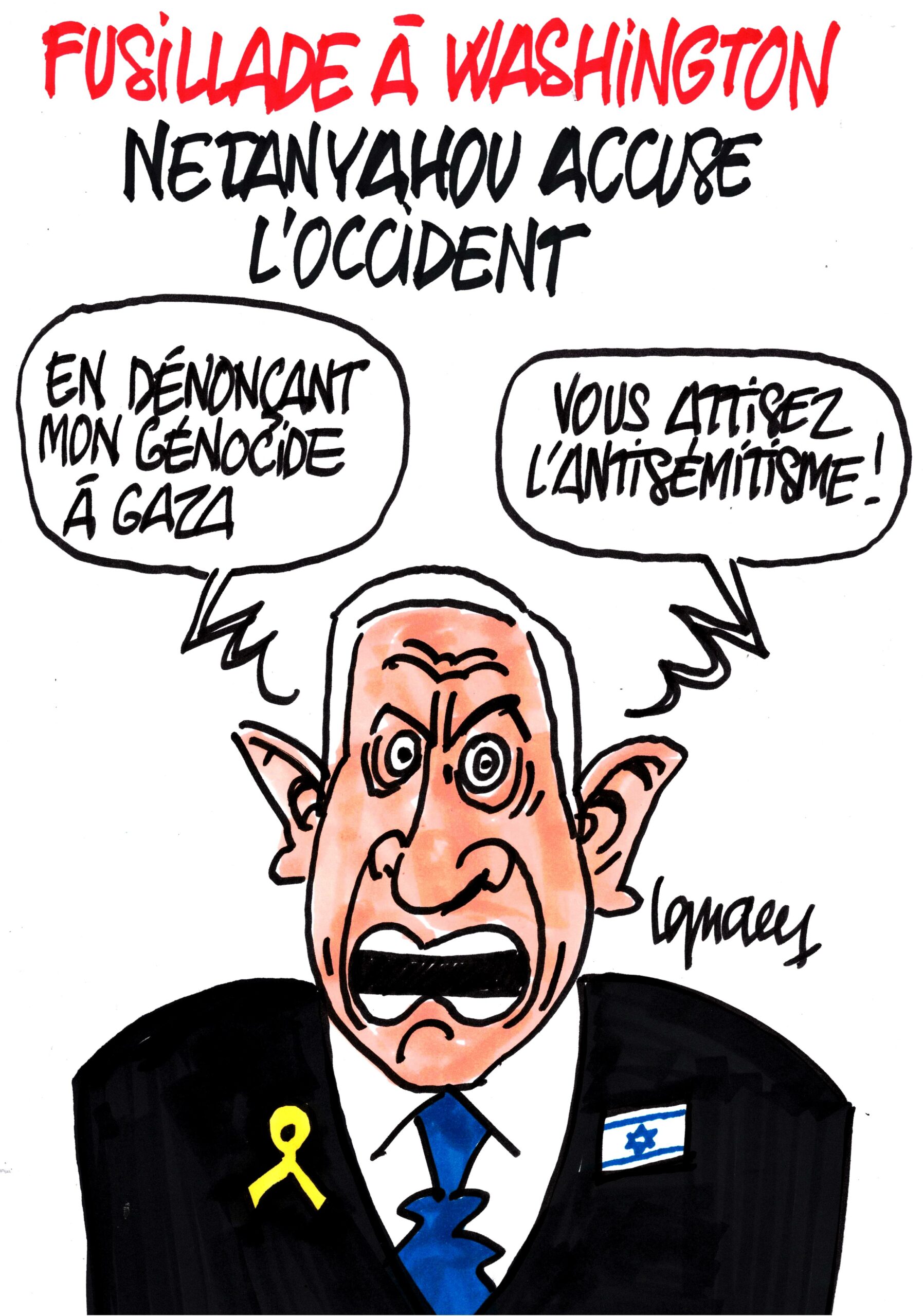






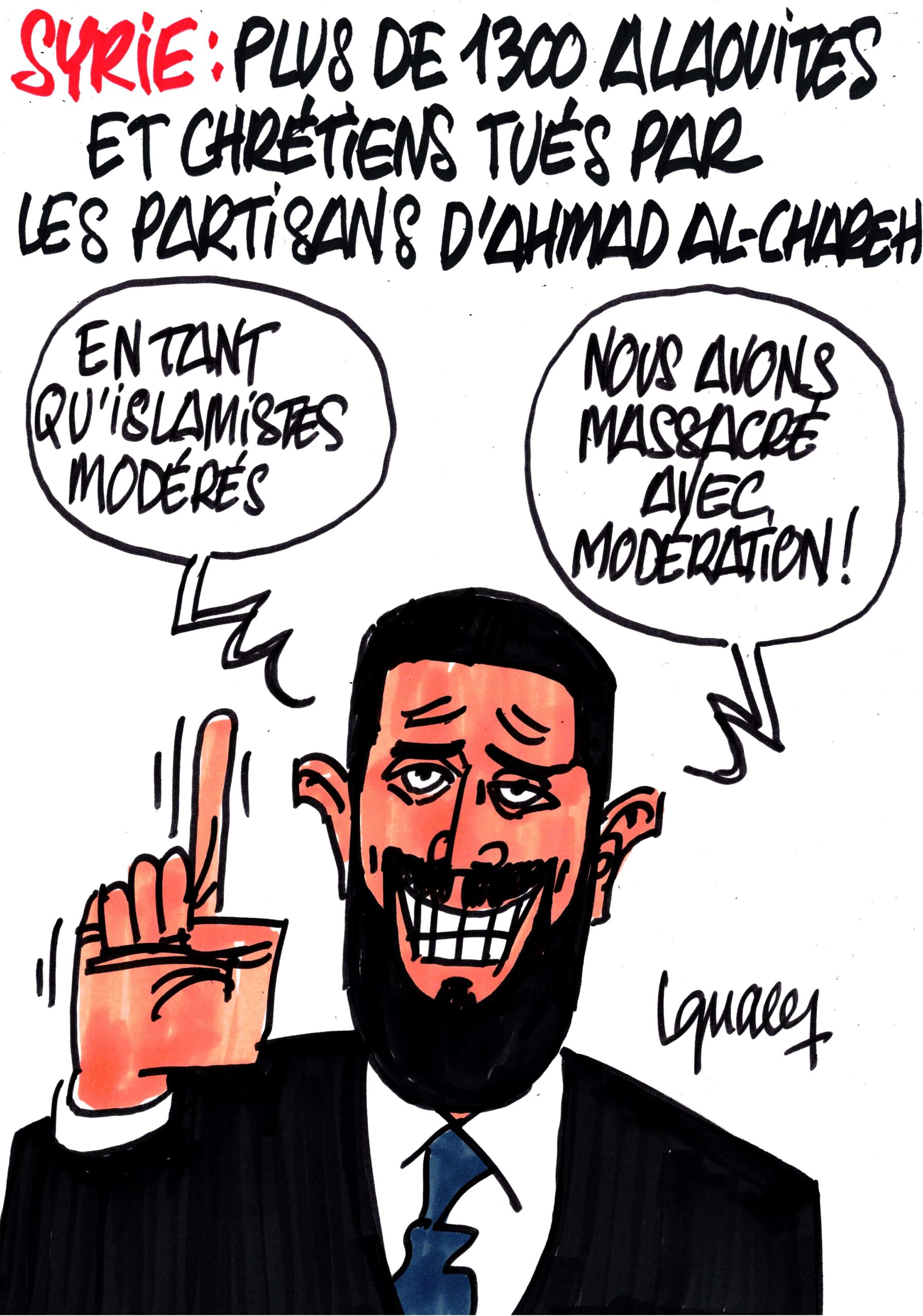












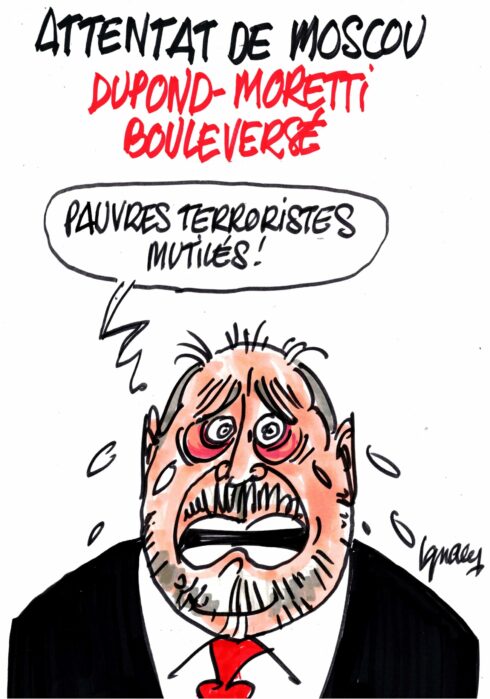






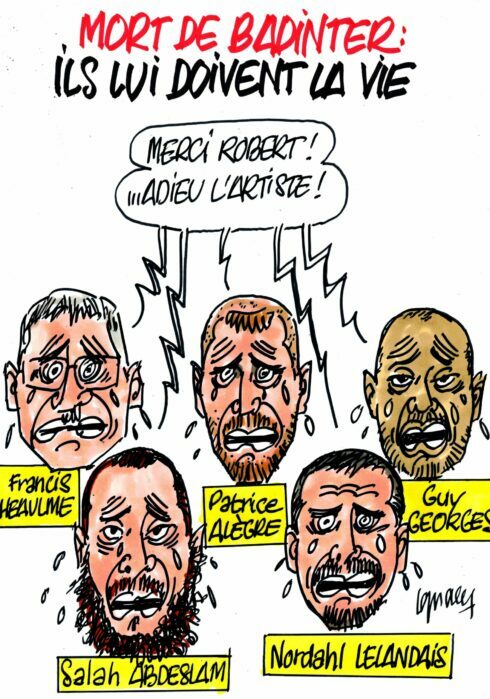







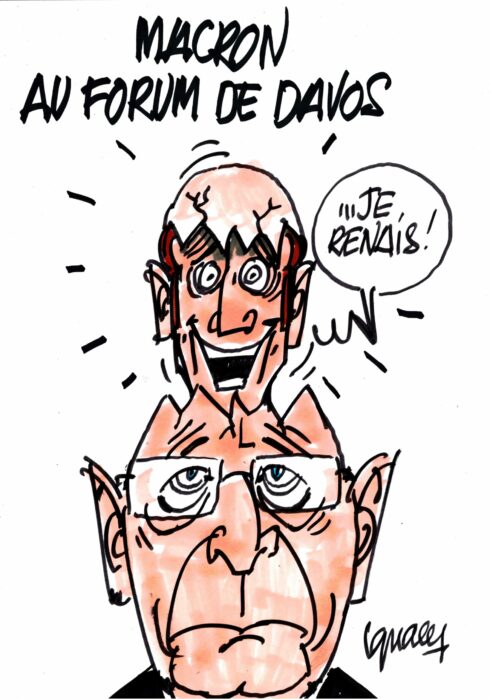




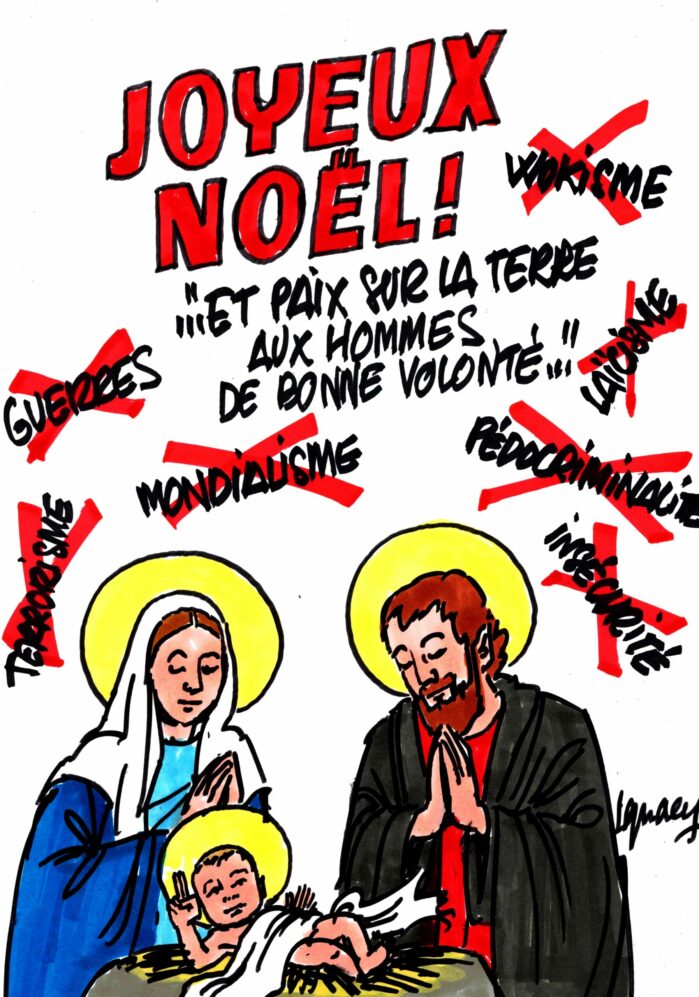


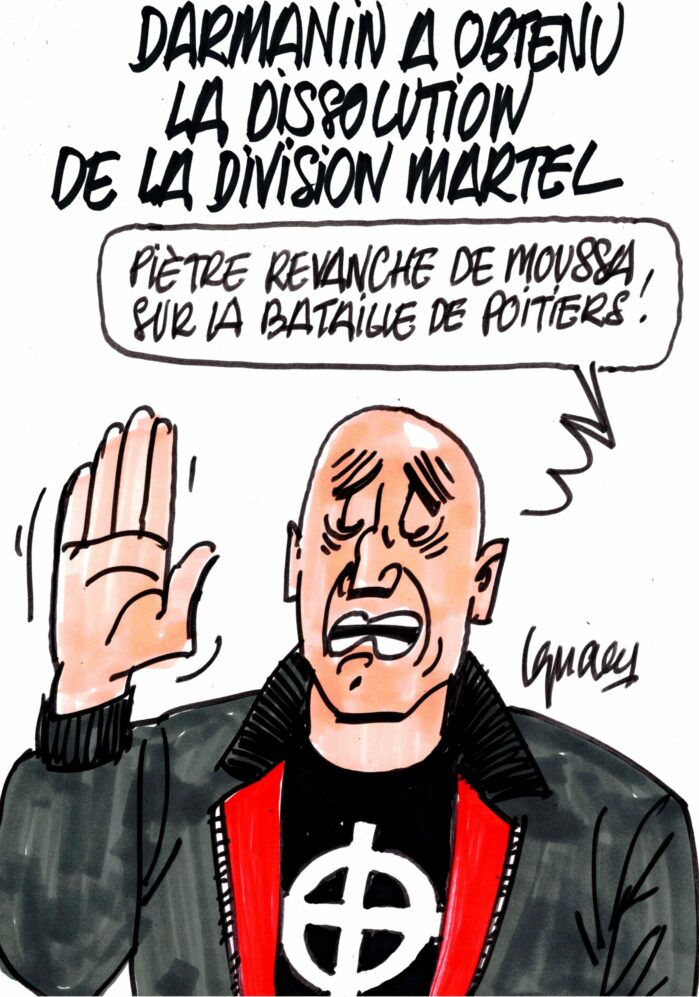

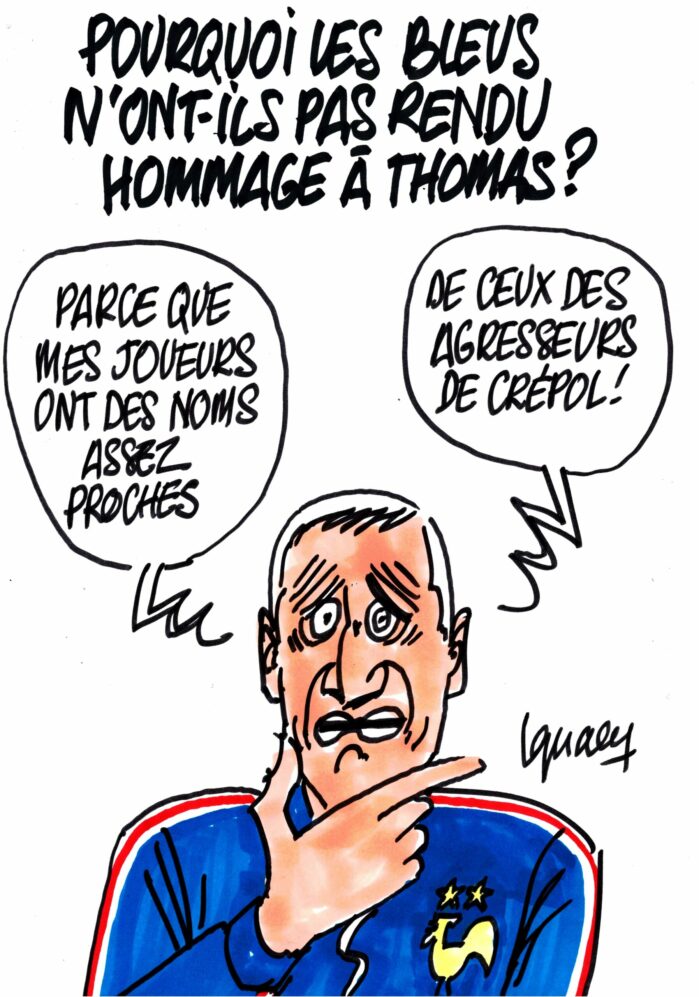







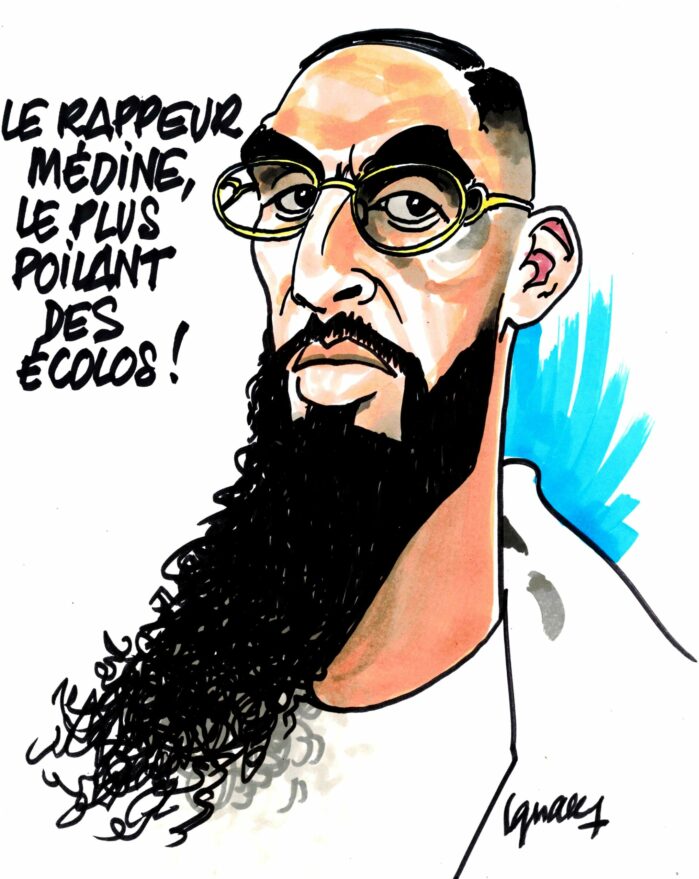











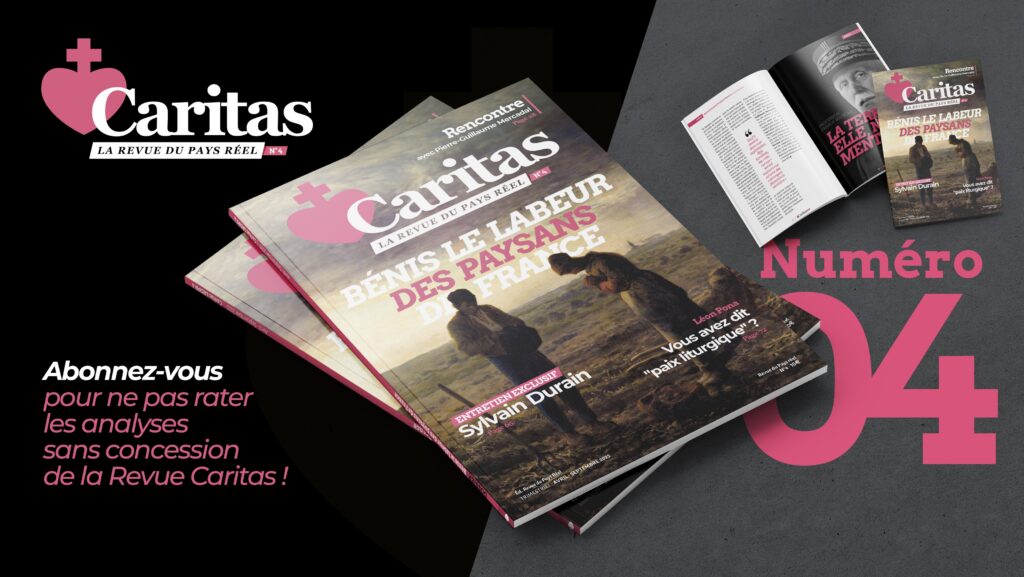
Commentaires