A Kinshasa depuis peu, j’avais décidé de me mettre en quête d’un magasin dans lequel acquérir un téléphone. Ils sont légions tant la téléphonie a pris rapidement mais profondément racine en Afrique. Je n’avais cependant pas d’idée précise et comptais y aller au gré du hasard. Déambulant sur le boulevard du 30 juin (l’avenue Louise à Bruxelles ou les Champs Elysées à Paris) dans cette effervescence frénétique de la villesi typique qu’il m’est malheureusement difficile à rendre, s’exhalait une touffeur relative. La saison sèche (de juin à septembre plus ou moins) a ceci de particulier que la température y est clémente, parfois fraîche. Déambulant donc, j’aperçus au loin une enseigne sur laquelle était écrit en grand le nom d’une marque coréenne et décidai de m’y rendre. A l’entrée, dehors, assis sur une chaise avec une kalachnikov sur les genoux, trônait un policier ; à ses côtés siégeait un agent de sécurité. La kalachnikov est à Kinshasa ce que le Jack Russel est à Uccle, une institution. On s’y habitue.Ces deux vigoureux compères somnolaient sur leur chaise, affrontant dignement la dureté de leur labeur. Il est de coutume de louer les services d’un policier à des fins de dissuasion. Non pas qu’il vous arrêterait en cas de flagrant délit ou interviendrait lors d’un vol – il devrait alors s‘éveiller – mais, lorsque tout est calme, il vous expliquerait plutôt que la vie est dure et que vous devez contribuer à en alléger les peines – dans la devise de votre choix…
J’entre donc dans l’établissement sous la protection de nos deux cerbères de qualité numérique. Une douce musique congolaise m’y accueille agréablement, l’air conditionné un peu plus abruptement. D’avenantes hôtesses sont présentes pour satisfaire le chaland. Mon but est clair : le gsm le moins cher. Je trouve assez rapidement un Nokia à 18.800 FC-20$. Je le désigne à une charmante gourgandine qui se propose de m’apporter son aide. Celle-ci me donne un ticket avec les références du téléphone, mon nom et m’indique l’endroit où je dois me rendre pour poursuivre la procédure d’achat. J’arrive devant un autre comptoir où, cette fois, deux commères[1] peu amènes siègent. Impressionné par son regard, je donne craintivement le ticket à celle qui dégage une naturelle autorité. Auguste, elle me toise, elle le regarde, le lit, ensuite – en prenant un temps dingue – le donne à sa voisine qui me regarde, me regarde encore, le regarde, le lit, retranscrit ce qui y figure dans un carnet et appelle une espèce de manutentionnaire. Je viens d’assister à ce que, dans les films de guerre américains,on appelle la chaîne de commandement, celle qu’il ne faut surtout pas rompre. Le manutentionnaire revient avec l’objet. Je m’acquitte de la somme due. La maman responsable me donne une facture, le téléphone et me dit en lingala « va au contrôle technique, papa ». Le contrôle technique… La maman, fine psychologue, saisit que je ne comprends pasde quoi il retourne et m’indique avec autoritarisme ce fameux contrôle technique. Un comptoir compartimenté en cinq confessionnaux permet à chaque contrôleur technique de s’occuper de son ouaille en toute intimité. Je m’approche. Les dits contrôleurs – ceux que je suppose tels – sont en plein colloque, en séminaire : ça rigole, commente, réagit, renchérit, apostrophe, s’énerve. Rien que de plus normal, c’est la sociabilité du pays. On daigne enfin tenir compte de ma présence en m’enjoignant vertement de poser mon séant sur une chaise devant l’un des compartiments. Intrigué, intimidé, penaud même, je m’exécute docilement. Le siège en face de moi reste vide un temps encore à tel point qu’un sentiment de déréliction finit par me gagner. Enfin, le contrôleur technique que l’on m’a assigné s’installe à son office. Il n’a pas un regard pour ma personne. Je sens le poids de son mépris. Il me dit sans me regarder : « téléphone ! papa », je le lui donne ; il continue : « facture ! papa », je la lui présente. C’est alors qu’une véritable liturgie à faire pâlir le cérémoniaire du pape s’enclenche. D’abord, il garde un silence assez long. Immobile, ilsemble se mettre en présence de Dieu. De manière délicate, il ouvre, tel un ciboire, la boîtequi contient le GSM et ses accessoires. Il sort le téléphone et le chargeur (les deux espèces). Il défait celui-ci, le branche sur une prise disposée à cet effet sur la table, installe la batterie du téléphone – on approche du canon de la messe – et charge le téléphone avec componction, déférence. Alors, extatique, irradié par la flamme de la foi, il me jette un regard prosélyte – c’est la première fois qu’il daigne accorder cet honneur au profane que je suis. Hiératique, montant en chair, il tourne le téléphone vers moi et me dit avec une certaine solennité : « ca fonctionne papa ». Effectivement, je lis sur l’écran du téléphone que ce dernier charge. Et ce contrôleur technique de remballer le tout, de me rendre la boîte, la facture et de retourner séance tenante colloquer avec ses comparses. Le contrôle technique vient d’avoir lieu. Le mystère est consommé. Ite missa est.
Tout ça pour ça ? Ils étaient cinq ces contrôleurs techniques. Ils étaient cinq à brancher le chargeur de GSM pour prouver leur bon état dans un magasin de taille somme toute moyenne. C’était leur métier, leur profession, leur unique tâche.
Sorti de l’établissement, je ne revenais toujours pas de la scène à laquelle j’avais assisté. Sans doute commune, banale, je la ressassais cependant, la ruminais, la digérais tantôt rigolant intérieurement tantôt dépité. Le drame de ce pays venait juste de se jouer devant moi, en résumé, en accéléré, en condensé dans cette tragédie téléphonique. Tout y était. L’essentiel comme l’accessoire. Nul besoin de verbeuses explications, d’intellectuels commentaires ; tout était dans le non-dit, dans la perception viscérale des pulsations du moment, tout se révélait dans l’instant vécu et non dans le récit que j’essaie maladroitement d’en faire.
Je ne pus alors m’empêcher de me demander où allait ce pays sans trouver le moindre élément de réponse.
C’est toujours le même effet, la même conclusion en regardant, en vivant une pièce congolaise : elle est foncièrement triste mais perçue, transmise avec une drôlerie imparable. On ne se pose même pas la question de savoir si on doit en rire. On en rit ! D’ailleurs, on en pleurera nécessairement. Les premières larmes seront sincèrement gaies, joyeuses ; les dernières seront filles d’une profonde amertume, d’une invincible douleur, d’un abyssal désespoir. C’est ça le Congo : une comédie foncièrement triste, absurde ; une profonde tristesse que seule cette drôlerie typiquement congolaise parvient à rendre avec justesse.
[1] La maman africaine est un condensé d’autoritarisme à vous faire passer un Staline pour le plus charmant des gentlemen.
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !





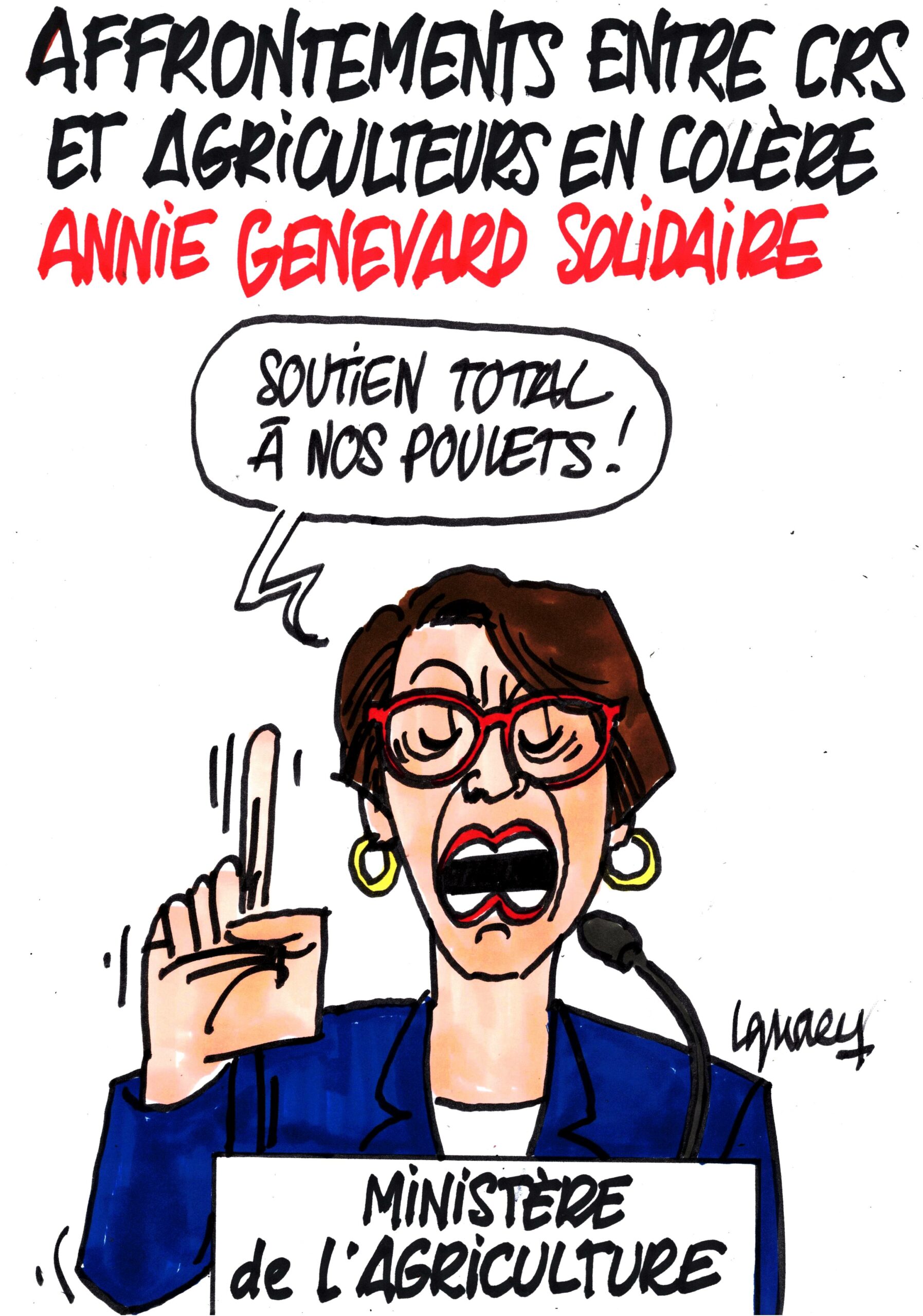
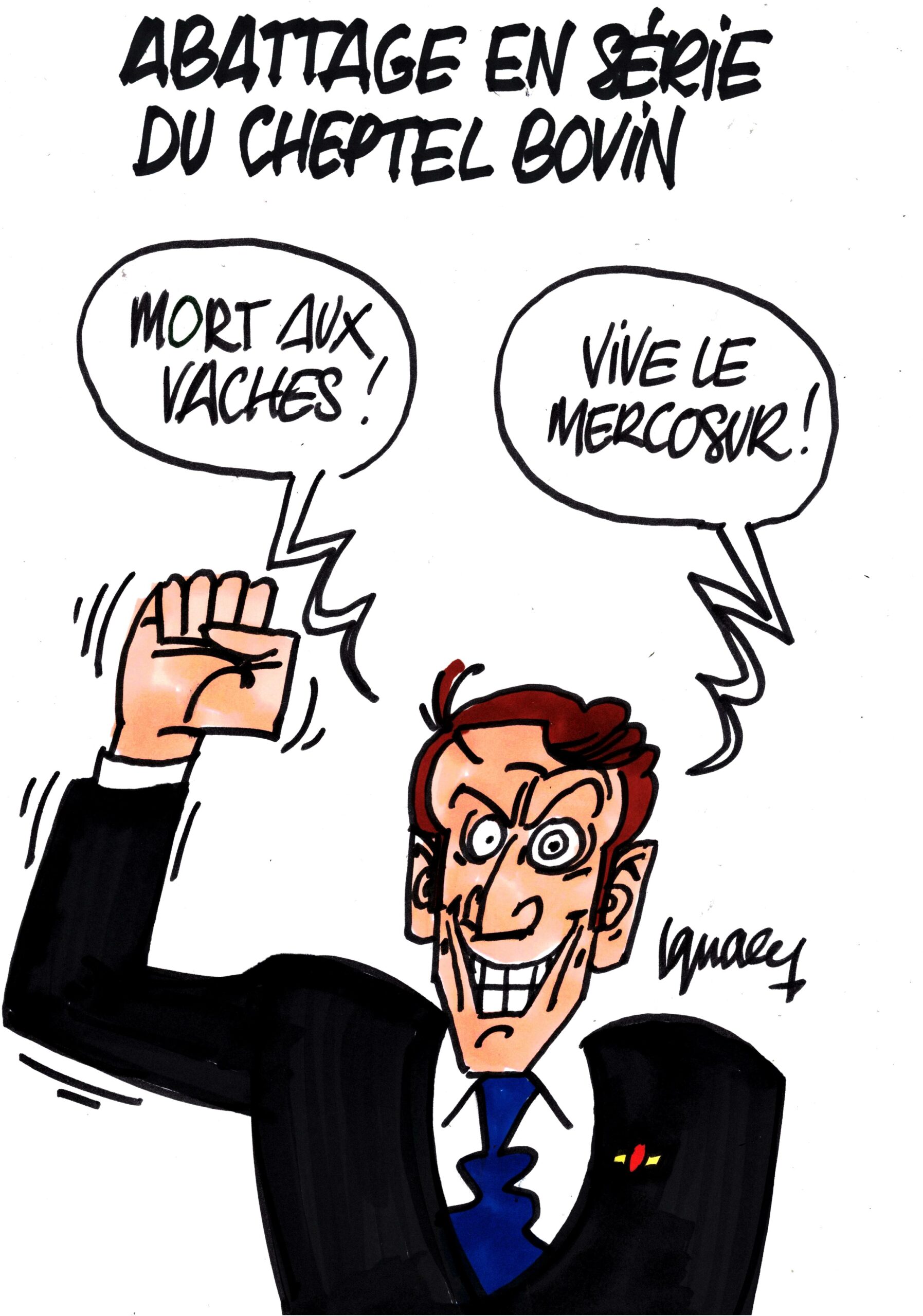




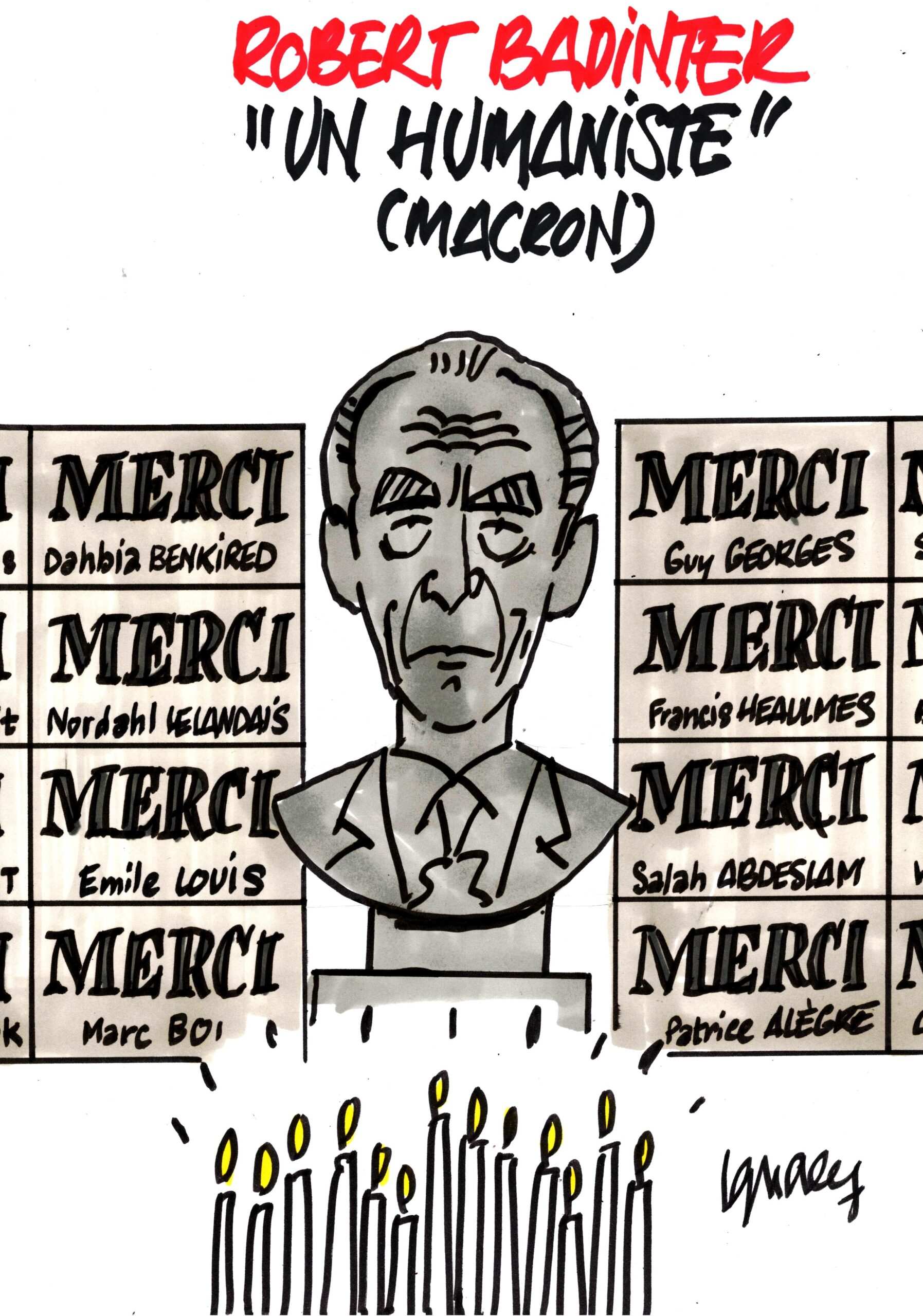

































































































Commentaires