XIII° Dimanche après la Pentecôte – « Dix lépreux vinrent au-devant de lui.» Le treizième Dimanche prend aujourd’hui son nom de l’Évangile des dix lépreux qu’on lit à la Messe.
A LA MESSE. L’Église, en possession des promesses si longtemps attendues par le monde, aime à revenir sur l’expression des sentiments qui remplissaient l’âme des justes durant ces siècles désolés où le genre humain végétait sous les ombres de la mort. Elle redoute le danger où se trouvent ses trop heureux fils d’oublier, dans leur abondance, les conditions désastreuses que l’éternelle Sagesse leur a épargnées, en les appelants à vivre dans les temps qui ont suivi l’accomplissement des mystères du salut. D’un tel oubli naîtrait sans peine l’ingratitude, condamnée à bon droit par l’Évangile du jour. C’est pourquoi l’Épître, et, avant elle, l’Introït, nous reportent au temps où l’homme vivait de la seule espérance, ayant bien la promesse d’une alliance sublime qui devait se consommer dans les siècles futurs, mais, cependant, dénué de tout, en butte aux perfidies de Satan, abandonné aux représailles de la justice divine en attendant de retrouver l’amour. Nous avons vu, il y a huit jours, le rôle de la foi et l’importance de la charité dans le chrétien vivant sous la loi de grâce. L’espérance aussi lui est nécessaire ; car bien que déjà en possession substantielle des trésors qui feront à jamais son bonheur, l’obscurité de cette terre d’exil les dérobe à sa vue, et, la vie présente restant toujours le temps d’épreuve où chacun doit mériter sa couronne, la lutte fait peser jusqu’au bout sur les meilleurs son incertitude et ses amertumes. Implorons donc avec l’Église, dans la Collecte, l’accroissement en nous des trois vertus fondamentales de foi, d’espérance et de charité ; pour mériter d’arriver à la consommation de tout bien qui nous est promise au ciel, obtenons la grâce de nous attacher de cœur à ces commandements de Dieu qui nous y conduisent, et que l’Évangile de Dimanche dernier résumait dans l’amour.
ÉPÎTRE. « Regarde le ciel et comptes-en, si tu peux, les étoiles : aussi nombreuse sera ta descendance. » Abraham avait près de cent ans, et la stérilité de Sara lui enlevait tout espoir naturel de postérité, quand le Seigneur lui parla de la sorte. Abraham cependant crut à Dieu, nous dit l’Écriture, et sa foi lui fut imputée à justice. Et quand, plus tard, la même foi lui eut fait offrir sur la montagne le fils de la promesse, son unique espérance, Dieu renouvela sa prophétie, et il ajouta : En ton germe seront bénies toutes les nations de la terre. Or voici qu’à cette heure la promesse s’accomplit ; l’événement donne raison à la foi d’Abraham. Il crut contre toute espérance, se confiant au Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui est comme ce qui n’est pas ; et voici que, selon la parole de Jean-Baptiste, des pierres mêmes de la gentilité surgissent en tous lieux des fils d’Abraham. Sa foi, en même temps si ferme et si simple, rendit à Dieu la gloire qu’il attend de la créature. L’homme ne peut rien ajouter aux perfections divines ; mais, sur la parole du Seigneur lui-même, quoique ne les voyant point directement ici-bas, il reconnaît ces perfections dans l’adoration et l’amour, il inspire de la foi sa vie entière ; et cet usage qu’il fait librement de ses facultés, cette adhésion spontanée d’un être intelligent, magnifie Dieu par l’extension de sa gloire extérieure. Sur les traces d’Abraham sont donc venues des multitudes nées pour le ciel de la foi dont il donna le spectacle au monde, vivant d’elle seule, rendant au Seigneur, dans tous leurs actes, l’hommage de la confession et de la louange par Jésus-Christ son Fils, et comme Abraham, recevant en retour la bénédiction d’une justice toujours croissante. Le splendide épanouissement de la sainte Église, qui suscite au père des croyants cette nouvelle descendance, s’est encore accentué depuis la chute d’Israël. Dans les contrées les plus reculées, au sein des villes jadis païennes, voyons ces foules nombreuses d’hommes, de femmes et d’enfants quittant comme Abraham [Gen. XII, 1.[]], à la voix du ciel, sinon leur pays, du moins tout ce qui les rattachait à la terre ; confiants comme lui dans la fidélité de Dieu et sa puissance, ils se sont faits étrangers au milieu de leurs proches et dans leurs maisons mêmes, usant de ce monde comme n’en usant pas. Dans le tumulte des cités comme au désert, au milieu des vains plaisirs de ce monde dont la figure passe, ils n’ont d’autre pensée que celle des réalités invisibles, d’autre souci que de plaire au Seigneur. Ils prennent pour eux la parole qui fut dite à leur père : Marche en ma présence, et sois parfait. C’était bien, en effet, à eux tous qu’elle s’adressait dès lors ; c’était la clause de l’alliance conclue par Dieu pour la suite des âges avec ces hommes fidèles, dans la personne du patriarche leur modèle et leur souche ; et Dieu répond de même à leur foi en d’intimes manifestations, ou par la voix plus sûre encore des Écritures, disant : Ne crains pas, je suis moi-même ta récompense immense ! Véritablement donc la bénédiction d’Abraham s’est répandue sur les nations . Jésus-Christ, vrai fils de la promesse, germe unique du salut, a par la foi dans sa résurrection rassemblé de toute race les hommes de bonne volonté, les faisant un en lui, les rendant comme lui fils d’Abraham et, qui mieux est, fils de Dieu. Car la bénédiction promise au début de l’alliance, c’était l’Esprit-Saint lui-même, l’Esprit d’adoption des enfants descendu dans nos cœurs pour faire de tous les héritiers de Dieu et les cohéritiers du Christ. Puissance merveilleuse de la foi qui brise les anciennes barrières de séparation, unit les peuples, et substitue l’amour et la liberté sainte des fils du Très-Haut à la loi d’esclavage et de défiance ! Pourtant ce spectacle grandiose des nations incorporées à la race élue, et devenant participantes en Jésus-Christ des promesses sacrées, n’agrée pas à tous. Le Juif charnel qui se vante d’avoir Abraham pour père sans se soucier d’imiter ses œuvres, le circoncis qui se glorifie de porter en sa chair les marques d’une foi qui n’est pas dans son cœur, ces hommes qui ont renié le Christ renient maintenant ses membres et voudraient repousser ou tronquer son Église. C’est avec rage qu’ils voient de tous les points de l’horizon ce concours immense que leur jalousie mesquine n’a pu arrêter. Tandis que leur orgueil froissé se tenait à l’écart, les peuples s’asseyaient en foule avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes, au banquet du royaume de Dieu ; les derniers devenaient les premiers. Jusqu’à la fin des temps, Israël, déchu par son obstination de son antique gloire, restera l’ennemi de cette postérité spirituelle d’Abraham qui l’a supplanté ; mais ses persécutions contre les fils de la promesse et l’Épouse légitime n’aboutiront qu’à faire voir en lui, comme dit saint Paul, le fils d’Agar, le fils de l’esclave exclue avec son fruit de l’héritage et du royaume. Libre à lui de repousser l’affranchissement que lui offrait le Seigneur, plutôt que de reconnaître l’abrogation définitive de sa loi périmée. Sa haine n’amènera point les fils de l’Église, figurée par Sara la femme libre, à rejeter la grâce de leur Dieu pour lui complaire, à délaisser la justice de la foi, les richesses de l’Esprit, la vie dans le Christ, pour retourner au joug de servitude brisé à jamais, quoi qu’en ait le Juif, par la croix qu’il dressa au Calvaire. Jusqu’à la fin la vraie Jérusalem, la cité libre notre mère, l’Épouse jadis stérile, maintenant si féconde, opposera aux prétentions surannées et cependant toujours vivaces de la synagogue, la lecture publique de l’Épître qu’on vient d’entendre. Jusqu’à la fin, Paul, en son nom, traitant de la loi du Sinaï signifiée aux hommes qu’elle concernait par l’intermédiaire de Moïse et des anges, fera ressortir son infériorité relativement à l’alliance conclue par Abraham directement avec Dieu ; chaque année, aussi fortement qu’au premier jour, il redira le caractère transitoire de cette législation venue quatre cent trente ans après une promesse qui ne pouvait changer, pour durer seulement jusqu’au jour où paraîtrait ce fils d’Abraham de qui le monde attendait la bénédiction promise. Mais que dire de l’impuissance du ministère mosaïque à fortifier l’homme, à le relever de sa chute ? L’Évangile que nous méditions il y a huit jours donnait de l’inutilité de l’ancienne loi sous ce rapport un symbolique et frappant commentaire, en même temps qu’il affirmait la puissance de guérison résidant dans le Christ et transmise par lui aux ministres de la loi nouvelle. Or, n’oublions pas que cet Évangile était autrefois l’Évangile du jour même où nous sommes. « Tout dans l’Office du treizième Dimanche, dit justement l’Abbé Rupert, se rapporte à l’histoire de ce Samaritain dont le nom signifie le gardien divin, notre Seigneur Jésus-Christ, venant par son incarnation au secours de l’homme que l’ancienne loi n’a pu sauver, et le remettant, quand il quitte la terre, aux soins des Apôtres et des hommes apostoliques dans l’hôtellerie de l’Église. La proximité voulue de cet Évangile jette une grande lumière sur notre Épître, ainsi que sur toute la Lettre aux Galates d’où elle est tirée. Le prêtre et le lévite de la parabole, en effet, c’est toute la loi représentée ; et leur passage auprès de l’homme à demi-mort qu’ils voient, sans chercher à le guérir, marque ce qu’a fait la loi. Elle n’allait point à l’encontre des promesses de Dieu, mais par elle-même ne pouvait justifier personne. Quelquefois le médecin qui ne doit pas venir encore envoie au malade un serviteur expert dans la connaissance des causes de maladie, mais inhabile à composer le remède contraire, et pouvant seulement indiquer à l’infirme les aliments, les breuvages dont il doit s’abstenir de crainte que son mal, en s’aggravant, n’amène la mort. Telle fut la loi, établie, nous dit l’Épître, à cause des transgressions, comme simple surveillante, jusqu’à l’arrivée du bon Samaritain, du médecin céleste. L’homme, en effet, tombé dès son entrée dans la vie entre les mains des voleurs, naît dépouillé de ses biens surnaturels et couvert des plaies que lui a faites le péché d’origine ; s’il ne s’abstient des péchés actuels, de ces transgressions pour l’indication desquelles la loi a été établie, il court risque de mourir tout à fait sans retour ». C’est pourquoi on reprend de nouveau, dans le Graduel, la supplication de l’Introït : Respice, Domine, in testamentum tuum. Car, dit Rupert, c’était la parole des anciens qui, gémissant sous l’infirmité de la loi impuissante du Sinaï, imploraient la consommation de l’alliance promise à la foi d’Abraham. Ils criaient au Christ, comme pouvait le faire au Samaritain libérateur le pauvre blessé qui voyait le prêtre et le lévite passer outre, sans apporter de remède à ses maux.
ÉVANGILE. Le lépreux Samaritain, guéri de sa hideuse maladie, figure du péché, en compagnie de neuf lépreux de nationalité juive, représente la race décriée des gentils admise d’abord comme à la dérobée, et par surcroît, en communication des grâces destinées aux brebis perdues de la maison d’Israël. La conduite différente que tiennent ces dix hommes, à l’occasion du miracle qui les concerne, répond elle-même à l’attitude des deux peuples dont ils sont l’image, en présence du salut apporté au monde par le Fils de Dieu. Elle démontre une fois de plus le principe posé par l’Apôtre : « Tous ceux-là ne sont pas Israélites qui sont nés d’Israël, tous ceux-là ne sont pas fils d’Abraham qui sont sortis de lui ; mais en Isaac, dit l’Écriture, est établie la race qui portera son nom : c’est-à-dire, ce ne sont pas les enfants nés de la chair qui sont les fils de Dieu, mais bien les fils de la promesse, nés de la foi d’Abraham et formant sa vraie race devant le Seigneur. » La sainte Église ne se lasse point de revenir sur cette comparaison des deux Testaments et le contraste offert par les deux peuples. C’est pourquoi, avant d’aller plus loin, nous sentons la nécessité de répondre à l’étonnement qu’une telle insistance ne peut manquer d’exciter en certaines âmes déshabituées de la sainte Liturgie. Le genre de spiritualité qui remplace aujourd’hui chez plusieurs l’ancienne vie liturgique de nos pères, ne les dispose en effet que médiocrement à entrer dans cet ordre d’idées. Accoutumés à ne vivre qu’en face d’eux-mêmes et de la vérité telle qu’ils la conçoivent, mettant la perfection dans l’oubli de tout le reste, il n’est pas surprenant que ces chrétiens ne comprennent aucunement ce retour continuel vers un passé fini, croient-ils, depuis des siècles. Mais la vie intérieure, vraiment digne de ce nom, n’est point ce que ces chrétiens s’imaginent ; aucune école de spiritualité, ni maintenant, ni jamais, ne plaça l’idéal de la vertu dans l’oubli des grands faits de l’histoire qui intéressent à ce point l’Église et Dieu même. Aussi qu’advient-il, trop souvent, de ce délaissement de la Mère commune par ses fils ? C’est que, dans l’isolement voulu de leurs prières privées, ils perdent de vue, par une juste punition, le but suprême de l’oraison qui est l’union et l’amour. La méditation dépouille en eux ce caractère de conversation intime avec Dieu, que lui assignent tous les maîtres de la vie spirituelle ; elle n’est bientôt plus qu’un exercice stérile d’analyse et de raisonnement, où l’abstraction domine en souveraine. Quand Dieu, cependant, voulut manifester son Verbe, en appelant l’homme aux noces divines, il ne recourut point à l’abstraction pour traduire à la terre ce fils de sa substance éternelle que l’homme ne pouvait voir encore directement dans sa divinité. Pareille traduction de l’éternelle Sagesse, où résident dans l’amour toute beauté, toute chaleur et toute vie, eût été plus qu’imparfaite et que froide. Aussi Dieu, selon l’expression de saint Paul, jeta dans la chair ce grand mystère de la piété ; le Verbe fut fait âme vivante ; l’éternelle Vérité prit un corps pour converser avec les hommes et grandit comme l’un d’eux. Et quand ce corps que la Vérité doit garder à jamais fut enlevé dans la gloire, l’Église, Épouse de l’Homme-Dieu, os de ses os, chair de sa chair, continua dans le monde cette manifestation de Dieu par les membres du Christ, ce développement historique du Verbe, qui ne s’arrêtera qu’au dernier jour, qui surpasse tout raisonnement, et révèle aux anges mêmes sous des aspects nouveaux la Sagesse de Dieu. Assurément un respect profond est dû aux axiomes où l’homme renferme dans un ordre logique, indépendant de l’histoire et des faits, les principes de la science ; mais pas plus en Dieu qu’en l’homme même, la vie ne répond à cette immobilité de raison qui ne ressemble en rien, qu’on se garde de le croire, à l’immutabilité toujours féconde, essentiellement active, de la Vérité substantielle. Or donc, dans l’Eglise comme en Dieu, la vérité est vie et lumière. S’il ne fallait y voir qu’une suite de formules, les accents de son Credo n’éclateraient pas aussi triomphants sous les voûtes de ses temples. S’il force victorieusement les portes du ciel, c’est que tous ses articles ont jusqu’à nous leur sublime histoire : c’est que chaque mot qui le compose se présente au Dieu très haut ruisselant du sang des martyrs ; que de siècle en siècle il rayonne toujours plus de l’éclat des travaux et des luttes glorieuses de tant de saints confesseurs, qui sont l’élite de l’humanité baptisée chargée de compléter le Christ ici-bas. Il nous faut abréger ces considérations. Disons donc de suite qu’après ce grand fait de l’incarnation du Verbe venu en terre pour manifester Dieu dans la suite des âges par le Christ et ses membres, il n’en est point de plus important, il n’en est point qui ait tenu, qui tienne encore davantage au cœur de Dieu, que l’élection des deux peuples appelés par lui successivement au bénéfice de son alliance. Les dons et la vocation de Dieu sont sans repentir, nous dit l’Apôtre ; ces Juifs, ennemis aujourd’hui parce qu’ils repoussent l’Évangile, n’en sont pas moins toujours aimés et très aimés, carissimi, à cause de leurs pères. C’est pourquoi aussi un temps viendra, attendu par le monde, où le reniement de Juda étant rétracté, ses iniquités effacées, les promesses reçues par Abraham, Isaac et Jacob auront leur accomplissement littéral. Alors apparaîtra la divine unité des deux Testaments ; les deux peuples eux-mêmes n’en feront plus qu’un sous le Christ leur chef. L’alliance de Dieu avec l’homme étant dès lors pleinement consommée telle qu’il l’avait voulue dans ses desseins éternels, la terre ayant donné son fruit, le monde ayant atteint son but, les tombes rendront leurs morts et l’histoire cessera ici-bas, pour laisser l’humanité glorifiée s’épanouir dans la plénitude de la vie sous le regard éternel. Rien donc n’est moins suranné que l’ordre d’idées auquel nous ramène de nouveau l’Évangile du jour ; rien n’est plus grand ; et ajoutons, quoi qu’il en puisse sembler à première vue : rien n’est plus pratique, dans cette partie de l’année consacrée aux mystères de la Vie unitive. Qu’est-ce, en effet, que l’union entre Dieu et l’homme, sinon tout d’abord la communauté des sentiments et des vues ? Or, nous venons de le montrer, les vues divines se trouvent résumées tout entières dans l’histoire comparée des deux Testaments et des deux peuples ; le résultat final qui clora l’histoire de ces rapports est l’unique but que poursuivait et que poursuive l’amour infini, au commencement, maintenant et toujours. L’Église donc, loin de se montrer d’un autre âge en revenant continuellement à ces pensées, ne fait que manifester ainsi l’éternelle jeunesse de son cœur d’Épouse à l’unisson toujours de celui de l’Époux. Reprenons brièvement l’explication littérale de notre Évangile, interrompue par cette longue digression. Ici encore donc le Seigneur veut plutôt nous instruire symboliquement, que montrer sa puissance. C’est pourquoi il ne rend pas d’un mot la santé aux malheureux qui l’invoquent, comme il le fit dans une autre circonstance pour un cas semblable »Je le veux, sois guéri, » dit-il un jour à un de ces infortunés qui implorait son secours dans les débuts de sa vie publique, et la lèpre avait disparu aussitôt. Les lépreux de notre Évangile, qui se rapporte aux derniers temps du Sauveur, sont délivrés seulement en allant se montrer aux prêtres ; Jésus les y renvoie, comme il l’avait fait pour le premier, donnant à tous, depuis le commencement jusqu’au dernier jour de sa vie mortelle, l’exemple du respect dû jusqu’au bout à l’ancienne loi non encore abrogée. Cette loi en effet donnait au fils d’Aaron le pouvoir, non de guérir, mais de discerner la lèpre et de prononcer sur sa guérison. Le temps est venu cependant d’une loi plus auguste que celle du Sinaï, d’un sacerdoce dont les jugements n’auront plus pour objet de constater l’état des corps, mais d’enlever effectivement, par le prononcé même de leur sentence d’absolution, la lèpre des âmes. La guérison rencontrée par les dix lépreux avant d’être arrivés aux prêtres qu’ils cherchent, devrait suffire à leur montrer dans l’Homme-Dieu la puissance du sacerdoce nouveau qu’annonçaient les prophètes ; le pouvoir qui surpasse pour eux, en la prévenant ainsi, l’autorité du ministère antique, révèle de soi dans celui qui l’exerce une dignité plus grande. Si, du moins, ils apportaient les dispositions convenables aux rites sacrés qui vont s’accomplir dans la cérémonie de leur purification, l’Esprit-Saint, qui régla autrefois, en vue du moment où ils sont, les prophétiques détails de cette fonction mystérieuse, les aiderait à comprendre la signification du passereau expiatoire dont le sang, versé sur les eaux vives, délivre par le bois l’autre passereau son semblable. Le premier, en effet, c’est le Christ, qui se compare dans le psaume au passereau solitaire ; son immolation sur la croix, qui donne à l’eau la vertu de laver les âmes, communique aux autres passereaux ses frères la pureté du sang divin. Mais le Juif est loin d’être préparé à l’intelligence de ces grands mystères. La loi pourtant lui fut donnée pour le conduire au Christ comme par la main et sans crainte d’erreur : faveur précieuse qu’il ne méritait point, qu’il devait à ses pères, et d’autant plus inestimable qu’au moment où elle lui fut accordée, la notion du sauveur à venir allait se corrompant toujours plus dans l’esprit des peuples. La reconnaissance eût dû s’imposer à Juda ; l’orgueil prit sa place. L’attache au privilège surmonte en lui le désir du Messie. Il refuse de se faire à la pensée qu’un temps viendra où, le Soleil de justice s’étant levé pour la terre entière, l’avantage fait à quelques-uns durant les heures de nuit s’effacera dans les flots surabondants d’une lumière égale pour tous. Il proclame donc sa loi définitive en dépit d’elle-même, affirmant ainsi l’éternité du règne des figures et des ombres. Il pose en dogme qu’aucune intervention divine n’égalera celle du Sinaï dans l’avenir, que tout prophète futur, tout envoyé de Dieu, ne pourra qu’être inférieur à Moïse, que tout salut possible est dans sa loi et que d’elle seule découle toute grâce. C’est la raison pour laquelle de ces dix hommes guéris par Jésus de la lèpre, il s’en trouve neuf qui ne songent même pas à venir remercier leur libérateur : ceux-là sont juifs, et Jésus n’est pour eux qu’un disciple de Moïse, un instrument des grâces provenant du Sinaï ; la formalité légale de leur purification accomplie, ils se croient quittes envers le ciel. Seul le Samaritain abandonné, le gentil, disposé par sa longue misère à l’humilité qui rend au pécheur la simplicité du regard de l’âme, reconnaît Dieu à ses œuvres et lui rend grâces pour ses bienfaits. Que de siècles d’abandon apparent, d’humiliation et de souffrance, devront passer sur Juda à son tour, pour qu’enfin, reconnaissant lui-même son Dieu et son Roi dans l’adoration, le repentir et l’amour, il entende comme cet étranger tomber de la bouche du Christ les paroles de pardon : Lève-toi et va, ta foi t’a sauvé !
Hâtons de nos vœux le moment si glorieux pour le ciel où les deux peuples, réunis dans une même foi par la conscience des mêmes espérances réalisées, s’écrieront au Christ, comme dans l’Offertoire : Seigneur, j’ai espéré en vous, vous êtes mon Dieu ! C’est l’oblation déposée sur l’autel qui doit nous obtenir de Dieu le pardon du passé et les grâces de l’avenir. Prions-le, dans la Secrète, d’agréer pour le Sacrifice ces dons présentés par l’Église en notre nom à tous. Quand donc les Juifs voudront-ils venir éprouver enfin la supériorité du pain de l’alliance nouvelle sur la manne du Vieux Testament ? Nous gentils, les derniers-venus, qui avons précédé nos aînés au banquet de l’amour, chantons d’autant mieux, dans la Communion, les divines suavités de ce vrai pain du ciel. Comme l’exprime la Postcommunion, l’œuvre de notre rachat par Jésus-Christ s’affirme et croit en nous aussi souvent que nous recourons aux sacrés Mystères. L’Eglise demande pour ses enfants la grâce de cette fréquentation fructueuse des Mystères du salut.
Sanctoral
Sainte Rose de Viterbe, Vierge du Tiers Ordre franciscain
A l’époque où Frédéric II d’Allemagne persécutait l’Eglise et s’emparait des Etats pontificaux, Dieu suscitait sainte Rose pour la défense de Viterbe, capitale du patrimoine de saint Pierre et du territoire qui appartenait au souverain pontife. Les noms de Jésus et Marie furent les premiers mots qui sortirent de la bouche de cette candide créature. Elle avait trois ans lorsque Dieu manifesta Sa toute-puissance en ressuscitant par son intermédiaire une de ses tantes qu’on portait au cimetière. Lorsqu’elle fut capable de marcher, elle ne sortait que pour aller à l’église ou pour distribuer aux pauvres le pain qu’on lui donnait. Un jour son père la rencontra en chemin et lui demanda d’ouvrir son tablier pour voir ce qu’elle portait. O prodige! Des roses vermeilles apparurent à la place du pain. Au lieu de s’amuser comme toutes les fillettes de son âge, Rose de Viterbe passait la plus grande partie de son temps en prière devant de saintes images, les mains jointes, immobile et recueillie. A l’âge de sept ans, elle sollicita instamment la permission de vivre seule avec Dieu dans une petite chambre de la maison. La petite recluse s’y livra à une oraison ininterrompue et à des austérités effrayantes qu’elle s’imposait, disait-elle, pour apaiser la colère de Dieu. Entre autres mortifications, sainte Rose marchait toujours les pieds nus et dormait sur la terre. Dieu lui révéla les châtiments éternels réservés aux pécheurs impénitents. Rose en fut toute bouleversée. La Très Sainte Vierge Marie lui apparut, la consola, la bénit et lui annonça que le Seigneur l’avait choisie pour convertir les pauvres pécheurs. «Il faudra t’armer de courage, continua la Mère de Dieu, tu parcourras des villes pour exhorter les égarés et les ramener dans le chemin du salut.» Une autre vision la fit participer au drame du Calvaire; dès lors, la soif de sauver les âmes ne la quitta plus. Sa pénitence aussi austère que précoce, réduisit le frêle corps de Rose à un tel état de faiblesse qu’on désespérait de sauver sa vie. La Très Sainte Vierge la visita de nouveau, la guérit miraculeusement et lui dit d’aller visiter l’église de St-Jean-Baptiste le lendemain, puis celle de St-François où elle prendrait l’habit du Tiers Ordre. Obéissante à la voix du ciel, elle commença à parcourir les places publiques de la ville de Viterbe vêtue de l’habit de pénitence, pieds nus, un crucifix à la main, exhortant la foule à la pénitence et à la soumission au Saint-Siège. Des miracles éclatants vinrent confirmer l’autorité de sa parole. Instruit de ce qui se passait, le gouverneur impérial de la ville de Viterbe craignit que cette enfant extraordinaire ne détruisit complètement le prestige de l’empereur Frédéric et que l’autorité du pape s’affirmât à nouveau. Il fit comparaître sainte Rose à son tribunal et menaçede la jeter en prison si elle continuait à prêcher. La servante de Dieu lui répondit: «Je parle sur l’ordre d’un Maître plus puissant que vous, je mourrai plutôt que de Lui désobéir.» Sur les instances d’hérétiques obstinés, sainte Rose est finalement chassée de Viterbe avec toute sa famille, en plein coeur de l’hiver. Peu après, sainte Rose de Viterbe annonça le trépas de l’ennemi de Dieu, Frédéric II d’Allemagne. En effet, il ne tarda pas à expirer étouffé dans son lit. A cette nouvelle, les habitants de Viterbe s’empressèrent de rappeler leur petite Sainte, absente depuis dix-huit mois. Celle que tous regardaient comme la libératrice de la patrie, la consolatrice des affligés et le secours des pauvres fut reçue en triomphe dans sa ville natale, tandis que le pape Innocent IV, ramené à Rome, rentrait en possession de Viterbe. Sa mission apostolique terminée, sainte Rose songea à réaliser son voeu le plus cher. Elle se présenta au couvent de Sainte-Marie-des-Roses, mais n’y fut pas acceptée, probablement à cause du genre de vie extraordinaire qu’elle avait menée auparavant. Rose vécut donc en recluse dans la maison paternelle, se vouant à la contemplation et aux plus rigoureuses pénitences. Plusieurs jeunes filles dont elle s’était déjà occupée la supplièrent de les prendre sous sa conduite. La demeure de la Sainte devint un véritable couvent où des âmes généreuses se livrèrent à l’exercice des plus sublimes vertus. L’élue de Dieu avait dix-sept ans et six mois lorsque le divin jardinier vint cueillir Sa rose toute épanouie pour le ciel, le 6 mars 1252. Au moment de rendre l’âme, elle dit à ses parents : « Je meurs avec joie, puisque je vais être unie à mon Dieu. Il ne faut pas avoir peur de la mort, elle n’est pas effrayante, mais douce et précieuse ». A l’heure de son glorieux trépas, les cloches sonnèrent d’elles-mêmes. Sainte Rose de Viterbe apparut au souverain pontife Alexandre IV pour lui demander de transporter son corps au monastère de Sainte-Marie-des-Roses, translation qui eut lieu six mois après sa mort. A cette occasion, son corps fut trouvé intact. Il se conserve encore, au même endroit, dans toute sa fraîcheur et sa flexibilité. D’innombrables miracles ont illustré son tombeau. Elle a été canonisée par le Pape Calixte III en 1457.
Sainte Rosalie, Vierge
Sainte Rosalie, du sang royal de Charlemagne, naquit à Palerme, en Sicile, d’un chevalier français et d’une parente de Roger, roi de Sicile. La Sainte Vierge lui apparut et lui conseilla de se retirer du monde. Rosalie, à quatorze ans, quitta le palais de son père sans avertir personne, n’emportant qu’un crucifix et des instruments de pénitence. Deux anges la conduisirent sur une montagne voisine de la ville. Dans une grotte inconnue et enveloppée de neige pendant plusieurs mois, Rosalie passa quelques années, partageant son temps entre l’oraison, la prière et la pénitence. Des racines crues faisaient sa nourriture; l’eau du rocher lui servait de boisson. Souvent elle recevait la visite des Anges, et le Sauveur Lui-même venait parfois S’entretenir avec elle. On voit encore dans cette grotte une petite fontaine qu’elle creusa pour réunir les eaux qui suintaient à travers les fissures de la roche; on voit aussi une sorte d’autel grossier et un long morceau de marbre où elle prenait son repas, un siège taillé dans le roc et une vigne très ancienne, qu’on croit avoir été plantée par elle. Aussitôt après sa disparition, sa famille la fit rechercher dans toute la Sicile. Les anges avertirent Rosalie qu’elle serait bientôt découverte, si elle ne changeait de demeure; elle prit aussitôt son crucifix et le peu d’objets qu’elle avait avec elle et suivit ses guides célestes; ils la conduisirent sur le mont Pellegrino, où ils lui indiquèrent une grotte obscure et humide qui lui servit de retraite pendant les dix-huit dernières années de sa vie.
Martyrologe
Sur le Mont Nébo, dans la terre de Moab, saint Moïse, législateur et prophète.
A Naples, en Campanie, l’anniversaire de sainte Candide, la première personne que saint Pierre rencontra en arrivant dans cette ville: baptisée par lui, elle fit plus tard une bienheureuse fin.
A Trèves, saint Marcel évêque et martyr.
A Ancyre, en Galatie (auj. Ankara, en Turquie), l’anniversaire des trois saints enfants martyrs, Rufin, Silvain et Vitalique.
Le même jour, les saints martyrs Magne, Caste et Maxime.
A Chalon-sur-Saône, en Gaule, saint Marcel martyr. Sous l’empereur Antonin, il fut invité par le gouverneur Prisque à un festin profane, mais, témoignant de l’horreur pour les repas de ce genre, il reprocha librement à ceux qui y prenaient part de rendre un culte aux idoles; alors, par une cruauté inouïe, le gouverneur le fit enterrer jusqu’à la ceinture. Marcel demeura trois jours dans cet état, ne cessant de louer Dieu, jusqu’à ce qu’il lui eût rendu son âme sans tache.
Le même jour, saint Thamel, autrefois prêtre des idoles, et ses compagnons martyrs, sous l’empereur Adrien.
De plus, les saints martyrs Théodore, Océan, Ammien, et Julien. Sous l’empereur Maximien, on leur coupa les pieds, puis on les jeta dans le feu où ils consommèrent leur martyre.
A Rome, saint Boniface Ier, pape et confesseur.
A Rimini, saint Marin diacre.
A Palerme, l’anniversaire de sainte Rosalie vierge, princesse du sang royal de Charlemagne. Elle renonça pour l’amour du Christ aux privilèges de sa naissance, s’enfuit de la cour et mena une vie céleste, solitaire dans les montagnes et les cavernes.
A Viterbe, la translation de la Bienheureuse vierge Rose, du Tiers-Ordre de saint François, à l’époque du pape Alexandre IV.
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !





























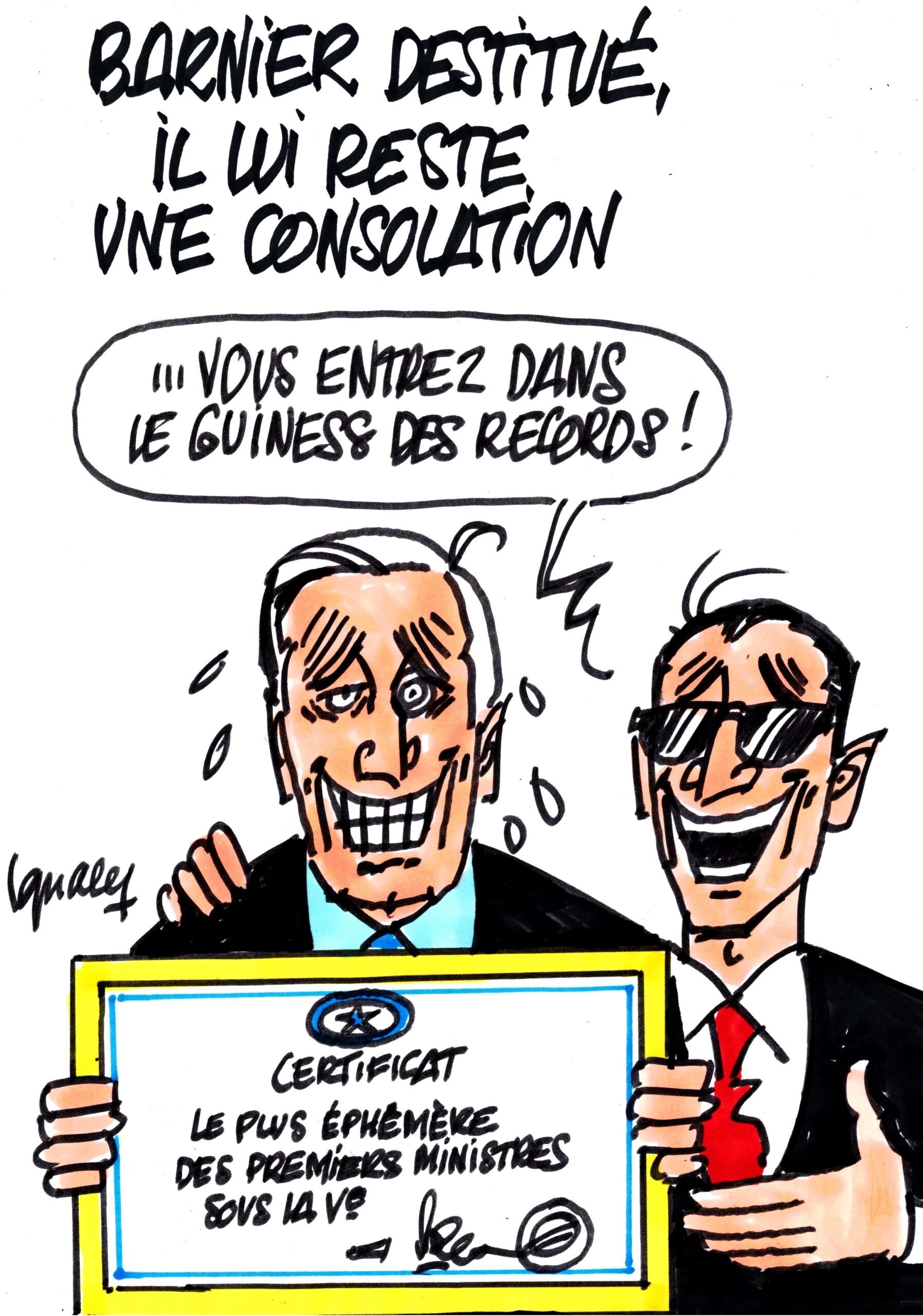


















































Commentaires