A quelques jours d’intervalle, René Girard et André Glücksmann viennent de nous quitter.
La terrible actualité a vite fait oublier ce double départ, mais on peut espérer qu’un regard, et une réflexion, sur deux vies d’intellectuels si dissemblables, contribuent plus à la compréhension du réel, que la fascination de l’immédiat lui-même, surtout quand il est atroce.
La différence entre ces deux célèbres intellectuels restera donc, extrême.
On serait tenté de les comparer à la cigale et à la fourmi de la célèbre fable, si on ne craignait pas d’offenser la cigale.
Côté fourmi, René Girard, né en 1924, a mené, dès l’âge de 24 ans, une carrière de professeur d’université aux Etats-Unis essentiellement consacrée à développer et à compléter systématiquement sa grande idée, le désir mimétique, dans une oeuvre composée d’une trentaine d’écrits.
André Glücksmann, né en 1937 de parents juifs moldaves communistes devenus agents soviétiques avérés, réussit à 13 ans à adhérer au PCF, après 68, il devint maoïste, partisan émerveillé de la révolution culturelle, et violemment opposé au « révisionnisme » de son parti originel.
En 1975 il rompit soudain avec le marxisme en menant, soutenu par son complice BHL, l’opération médiatique des « nouveaux philosophes » anti-totalitaires qui exploitaient l’effet produit en France par l’oeuvre de Soljenitsyne.
Avec un certain nombre « d’intellectuels » il passe en 1977 par l’ultra-libéralisme « moral » et la défense de la pédophilie, avant de devenir dans les années 80 « atlantiste », soutenant les guerres contre l’Irak, puis contre la Serbie, la « cause tchétchène » contre Poutine, l’intervention en Libye, la « cause tibétaine » contre la Chine, et en 2009 Israël contre Gaza.
Quelles constantes peut-on dégager dans ce tourbillon dont nous sautons quelques épisodes ? Le modèle extrême du parcours « philosophique » dominant d’une génération de privilégiés, sa grande soumission de pensée et d’action aux courants hégémoniques du moment, bons ou mauvais, son absence de nuances, associée à son intransigeance, surtout quand il se reniait, et enfin sa grande capacité, la plupart du temps, à occulter les réalités les plus profondes et ainsi à se tromper de camp, ou à choisir le plus vicieux d’entre eux.
Pendant ce temps, à distance des passions du temps, René Girard construisait progressivement une théorie anthropologique globale, qu’il pensait avoir découverte grâce aux grands écrivains (dans Mensonge romantique et vérité romanesque en 1961) : l’imitation est humaine, et nous désirons ce que l’autre désire, d’où rivalités et violence généralisée qui ne se résout que par le mécanisme de la détermination d’un bouc émissaire, que l’on sacrifie et que l’on divinise ensuite (La violence et le Sacré), ce qui apaise pour un temps les conflits et fonde la religion archaïque et, par là même, la culture.
Avec Des choses cachées depuis la fondation du monde qui, en1978, empruntait son titre à l’évangile de Saint Mathieu (13,35), René Girard pose le troisième étage de son édifice : la Passion du Christ n’est pas, contrairement aux apparences, une reproduction ordinaire du mécanisme sacrificiel, car la victime étant, cette fois, manifestement innocente, elle détruit ce mécanisme, et tout est transformé.
Sans doute cette pensée, distanciée des événements immédiats, est-elle plus profonde que les variations de Glücksmann. Est-il cependant certain qu’elle soit tellement plus sage ?
La découverte que pense avoir faite René Girard a été aussi séduisante pour les uns, et par eux sanctifiée, qu’elle a été contestée ou méprisée par les autres, et le jugement d’Alain de Benoist sur l’inaptitude de René Girard au dialogue, donne à réfléchir : « il se contentait d’affirmer sans jamais démontrer ».
Sans se rallier au dénigrement systématique du pamphlet de René Pommier : « René Girard, un allumé qui se prend pour un phare », qui ne manque pourtant ni d’arguments, ni d’humour féroce contre une construction théorique qui représente l’oeuvre d’une vie, situons nous du point de vue de la Foi catholique, dont René Girard se réclamait (et dont plus d’un catholique admiratif semble avoir en l’occurence oublié la doctrine).
Dieu ne se serait-Il incarné que pour libérer l’homme d’un mécanisme, qui serait lui-même nécessairement engendré par une nature humaine créée par Dieu ? Dans la théorie Girardienne, la responsabilité de l’homme dans la chute originelle n’apparaît pas, et Satan n’est ici que le mécanisme sacrificiel, avec la tentation d’y retomber toujours. Le Christ, en grand animateur et sociologue qui provoque le psychodrame libérateur, ne viendrait pas pour rétablir la relation rompue entre l’homme et Dieu mais seulement pour établir entre les hommes, les bonnes relations sans lesquelles ils disparaîtront. René Girard semble oublier qu’au-dessus de toute mécanique sociale, il y a le destin personnel de chacun, et son salut. Dans son évocation de la Passion, la mort comme telle, et la Résurrection du Christ sont absentes. La mort humaine est pourtant un fait, nullement hypothétique, qui doit avoir quelque place dans le religieux et dans le social que l’hypothèse mimétique n’inclut pas.
Il s’agit en fait d’une gnose très réductrice, dans laquelle tout mystère disparaît. En effet, comme le relève Paul Valadier, philosophe et jésuite, si René Girard parle d’une conversion et d’une grâce, c’est à propos de sa propre théorie qui relèverait bientôt de l’évidence, en se prétendant scientifique.
Le sage, nous dit Aristote, est celui qui ordonne selon les principes.
René Girard, dans ses pensées et dans ses oeuvres, semble a priori plus sage qu’André Glücksmann dans les siennes, et plus à même d’éclairer ce que nous vivons, mais le véritable sage, vis-à-vis des choses anciennes comme des nouvelles, doit, sans s’enivrer de ses trouvailles, s’assurer des vrais principes.
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !















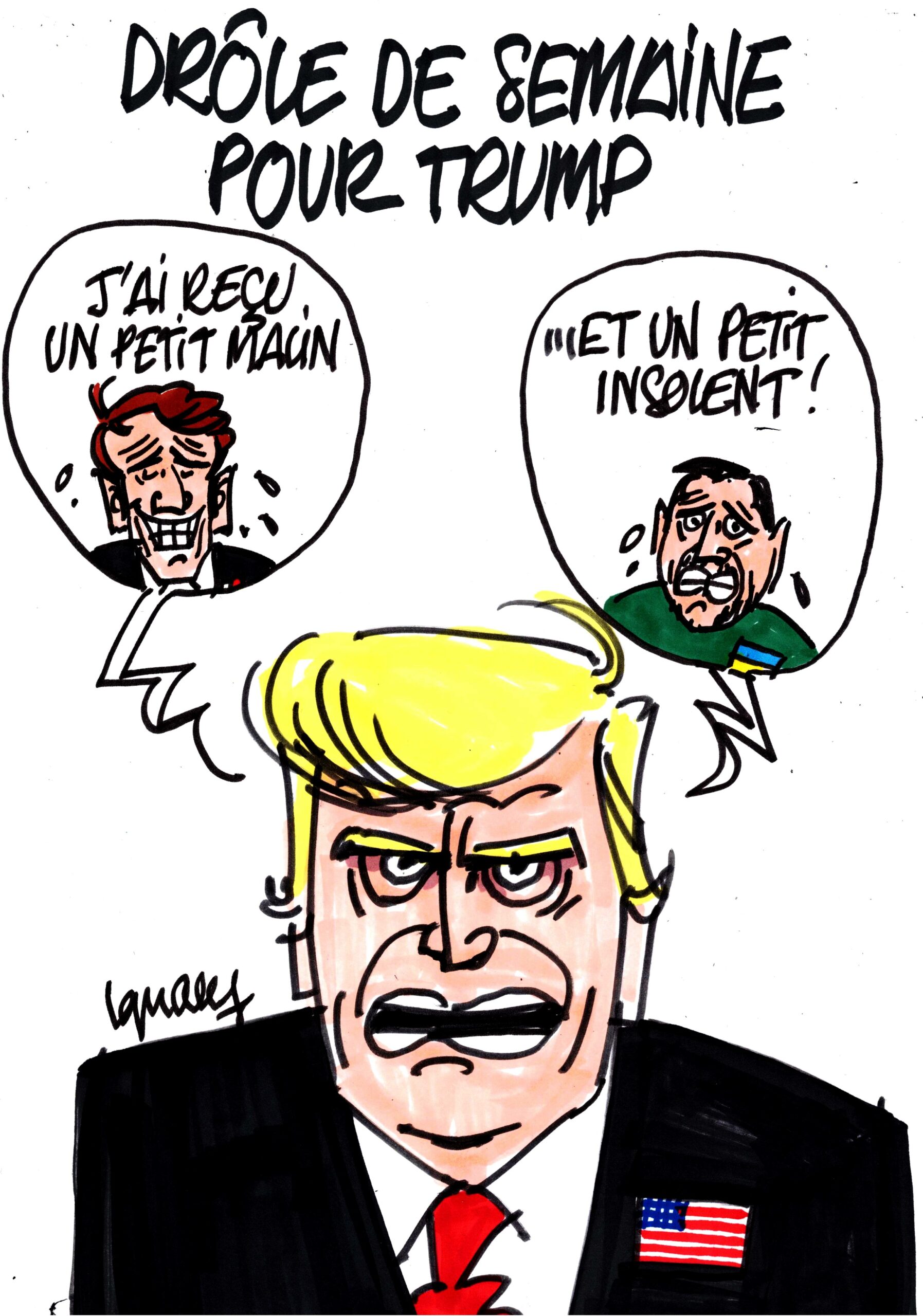





























































La droite insurrectionnelle européenne ne changera rien. Ces élections ne sont qu’une mascaradePublié le juin 12, 2024 par Wayan
 Selon votre position politique, vous allez considérer la poussée de la droite populiste au Parlement européen comme une grave menace pour la démocratie, ou comme une victoire éclatante de celle-ci – et un grand pas en avant dans la « reprise en main » de l’oligarchie bruxelloise. Mais les deux positions sont erronées. En réalité, malgré l’hystérie d’hier, aggravée par la décision de Macron de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections anticipés, l’impact de celle-ci ne sera pas aussi important que les gens le craignent ou l’espèrent.
Selon votre position politique, vous allez considérer la poussée de la droite populiste au Parlement européen comme une grave menace pour la démocratie, ou comme une victoire éclatante de celle-ci – et un grand pas en avant dans la « reprise en main » de l’oligarchie bruxelloise. Mais les deux positions sont erronées. En réalité, malgré l’hystérie d’hier, aggravée par la décision de Macron de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections anticipés, l’impact de celle-ci ne sera pas aussi important que les gens le craignent ou l’espèrent.
Par Thomas Fazi – Le 10 juin 2024 – Source Unherd
Prenons les vainqueurs : les groupes ECR et ID, qui ont réalisé des gains significatifs. Ces deux blocs sont constitués de divers partis de droite populistes qui sont profondément divisés sur plusieurs questions stratégiques cruciales : les questions sociales et économiques, l’élargissement de l’Europe, la Chine, les relations entre l’UE et les États-Unis et, surtout, l’Ukraine. Cela signifie que, même s’ils parviennent à pousser la Commission européenne vers la droite, ils auront du mal à transformer leur succès électoral en influence politique ; sur les défis les plus importants de l’Europe, il semble peu probable qu’ils votent en bloc. Mais à un niveau plus fondamental, supposer que ces élections modifieront radicalement le cours de l’agenda politique de l’UE, voire menaceront la démocratie elle-même, implique que l’UE est une démocratie parlementaire qui fonctionne. Ce n’est pas le cas.
Malgré la fanfare qui entoure chaque élection européenne – chacune d’entre elles étant fastidieusement décrite comme « les élections les plus importantes de l’histoire de l’Union européenne » – la réalité est que le Parlement européen n’est pas un parlement au sens conventionnel du terme. Cela impliquerait qu’il ait la capacité d’initier une législation, un pouvoir que le Parlement européen n’exerce pas. Ce pouvoir est exclusivement réservé à l’organe « exécutif » de l’UE, la Commission européenne – ce qui se rapproche le plus d’un « gouvernement » européen – qui s’engage à « ne solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune institution, d’aucun organe, d’aucune fonction ni d’aucune entité ».
Et cela inclut inévitablement le Parlement européen, qui ne peut qu’approuver, rejeter ou proposer des amendements et des révisions aux propositions législatives de la Commission. La Commission elle-même n’est en aucun cas élue démocratiquement. Son président et ses membres sont proposés et nommés par le Conseil européen, composé des dirigeants des États membres de l’UE. Même dans ce cas, le Parlement ne peut qu’approuver ou rejeter les propositions du Conseil. D’où le paradoxe d’Ursula von der Leyen qui mène une campagne électorale (comiquement dérangeante) pour un second mandat alors qu’elle ne brigue aucun siège.
En 2014, ce problème était censé être résolu : un nouveau système – le « Spitzenkandidat », ou processus du « candidat principal » – a été introduit, selon lequel, avant les élections européennes, chaque grand groupe politique du Parlement européen désignerait son candidat au poste de président de la Commission, et le candidat du groupe ayant le plus grand nombre de sièges deviendrait automatiquement président. Mais le système n’a jamais été mis en œuvre. En effet, en 2019, Von der Leyen elle-même a été choisie à huis clos par les dirigeants de l’UE, malgré le fait qu’elle ne s’était pas présentée aux élections et que deux candidats avaient déjà été proposés par les groupes de centre-droit PPE et de centre-gauche S&D. Aujourd’hui, ce système est considéré comme quasiment mort, ce qui explique pourquoi les autres groupes n’ont même pas pris la peine de choisir un candidat.
Pourtant, malgré ces contraintes démocratiques, à en juger par les résultats d’hier, on pourrait affirmer que même l’UE ne peut rester totalement isolée du glissement à droite du continent. C’est vrai : le poids accru des populistes de droite au sein du Parlement européen pourrait contraindre le Conseil à présenter un candidat plus à droite que Von der Leyen.
Avant de tomber dans le piège de la prédiction d’une dystopie populiste de droite, il convient toutefois de faire quelques mises en garde importantes. S’il est vrai que la Commission est nommée par les gouvernements nationaux et qu’il peut donc sembler que ces derniers ont le contrôle, il est tout aussi vrai que les institutions supranationales de l’Union européenne exercent une influence considérable sur les gouvernements nationaux, dans la mesure où elles contrôlent des aspects cruciaux de leur politique économique. C’est particulièrement vrai dans la zone euro, où la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE) peuvent effectivement imposer la politique qu’elles souhaitent aux gouvernements élus – et même les démettre de leurs fonctions par la force, comme elles l’ont fait avec Silvio Berlusconi en 2011.
Cela signifie que, dans la zone euro du moins, la survie politique des gouvernements dépend largement de la bonne volonté de l’UE. C’est pourquoi même les partis populistes de droite, une fois qu’ils sont entrés au gouvernement – ou commencent à penser qu’ils ont de bonnes chances d’y parvenir – ont tendance à se réaligner rapidement sur l’establishment, tant au Conseil européen qu’au Parlement européen. Prenons l’exemple de Giorgia Meloni. Sur toutes les questions importantes, la première ministre italienne a aligné son gouvernement sur l’UE et l’OTAN – et a fait part de sa volonté de soutenir un second mandat de Mme von der Leyen, avec laquelle elle a développé une relation étroite. En France, Marine Le Pen a également entamé un processus de « melonification », abandonnant son programme anti-euro et assouplissant sa position sur la Russie-Ukraine et l’OTAN. Même si son parti, le Rassemblement national, remporte les prochaines élections en France, tout porte à croire qu’il ne sera pas la force perturbatrice qu’elle promet.
Il y a également un autre point à prendre en considération. D’une part, le fait que le Parlement européen, la seule institution démocratiquement élue dans l’UE, exerce un certain contrôle sur les politiques de la Commission, peut être considéré comme un développement positif. En ce sens, la présence accrue des partis populistes de droite aura certainement un impact sur le processus législatif, en particulier sur des questions hautement polarisantes telles que le Green Deal européen et l’immigration.
Mais d’un autre côté, cela ne change rien au fait que le Parlement européen reste politiquement impuissant. L’ensemble du processus législatif – qui se déroule dans le cadre d’un système de réunions tripartites informelles sur les propositions législatives entre les représentants du Parlement, de la Commission et du Conseil – est pour le moins opaque. Comme l’ont écrit les chercheurs italiens Lorenzo Del Savio et Matteo Mameli, cette situation est exacerbée par le fait que le Parlement européen est « physiquement, psychologiquement et linguistiquement plus éloigné des citoyens ordinaires que ne le sont les parlements nationaux », ce qui le rend plus sensible à la pression des lobbyistes et des intérêts particuliers bien organisés. Par conséquent, même les hommes politiques les mieux intentionnés, une fois arrivés à Bruxelles, ont tendance à être aspirés dans sa bulle.
À un niveau encore plus fondamental, rien de tout cela ne changera jamais, même si le Parlement européen se voit accorder les pleins pouvoirs législatifs, pour la simple raison qu’il n’y a pas de demos européen que le Parlement puisse représenter. Un tel demos – une communauté politique généralement définie par une langue, une culture, une histoire et un système normatif communs et relativement homogènes – n’existe encore qu’au niveau national. En effet, l’UE reste profondément fracturée par des lignes de fracture nationales économiques, géopolitiques et culturelles, et il semble peu probable que cela change.
Tout cela signifie que, même si nous pouvons nous attendre à un changement de direction sur certaines questions, ces élections ne résoudront probablement pas les problèmes économiques, politiques et géopolitiques urgents qui affligent l’UE : stagnation, pauvreté, divergences internes, privation des droits démocratiques et, ce qui est peut-être le plus crucial pour l’avenir du continent, la nationalisation et la militarisation agressives du bloc dans le contexte de l’escalade des tensions avec la Russie. En ce sens, il n’est guère surprenant qu’environ la moitié des Européens n’aient même pas pris la peine de voter. En fin de compte, l’UE a été construite précisément pour résister aux insurrections populistes telles que celle-ci. Plus vite les populistes l’admettront, mieux ce sera.
Thomas Fazi
Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.